
Et c'est parti pour dix-huit mois d'hystérie. Les geeks sont déjà au bord de l'insomnie, à l'affut de toute information croustillante qui leur permettra de rêver en attendant sa sortie en salles. Les sites sur le cinéma n'hésitent plus à balancer en "Une" de courts textes portant sur la moindre rumeur qui ébranle la toile, ayant ainsi l'assurance d'obtenir un maximum de "clics" en un minimum de temps. Ce projet qui attirera tous les regards jusqu'en décembre 2016 est évidemment Star Wars VII de J.J. Abrams. Et autant le dire, on n'avait pas vu pareille surexcitation collective pour un film depuis celle qui avait précédé la sortie de... Star Wars - Episode I : La Menace Fantôme de George Lucas.
 Souvenez-vous, c'était en 1999, soit une éternité à l'échelle d'Internet où toute "news" est quasiment périmée avant même qu'elle n'ait eu le temps d'être massivement diffusée. Le long métrage de George Lucas était alors attendu comme le Messie car celui-ci marquait le début de la préquelle en trois épisodes devant révéler ce qui s'était passé avant les évènements relatés dans la trilogie originale de La Guerre des Etoiles, une oeuvre profondément ancrée dans l'inconscient collectif et apparaissant à juste titre comme l'un des pilliers de la culture populaire moderne. Sorti en 1977, le premier opus de Star Wars reçut, contre toute attente et malgré une production infernale pour son instigateur, un triomphe d'une ampleur inédite dans l'Histoire du cinéma. Comme le montrent ces images sidérantes du Chinese Theater à Los Angeles en mai 1977, les files d'attente aux Etats-Unis pour chaque séance s'étendaient jusque dans les rues, et ce, parfois sur plusieurs "blocs". Tout le monde voulait voir ce "space opera" dont tout le monde parlait. Tout le monde voulait voir ce phénomène qui déchainait la masse. Tout le monde voulait y participer, le vivre et l'intégrer afin de pouvoir dire à son tour : "Moi aussi, j'ai découvert Star Wars au cinéma". Les "vieux" critiques de l'époque étaient dépassés. En France, les remarques dédaigneuses ont fusé afin de tenter futilement de minimiser l'impact gigantesque que le film était en train d'engendrer à l'échelle mondiale (et non pas uniquement dans le milieu hollywoodien) tout en essayant de montrer qu'ils - l'intelligencia - n'étaient pas dupes face à ce gros jouet bruyant rempli d'effets visuels hallucinogènes visant à satisfaire de jeunes dépravés accrocs aux substances LSD.
Souvenez-vous, c'était en 1999, soit une éternité à l'échelle d'Internet où toute "news" est quasiment périmée avant même qu'elle n'ait eu le temps d'être massivement diffusée. Le long métrage de George Lucas était alors attendu comme le Messie car celui-ci marquait le début de la préquelle en trois épisodes devant révéler ce qui s'était passé avant les évènements relatés dans la trilogie originale de La Guerre des Etoiles, une oeuvre profondément ancrée dans l'inconscient collectif et apparaissant à juste titre comme l'un des pilliers de la culture populaire moderne. Sorti en 1977, le premier opus de Star Wars reçut, contre toute attente et malgré une production infernale pour son instigateur, un triomphe d'une ampleur inédite dans l'Histoire du cinéma. Comme le montrent ces images sidérantes du Chinese Theater à Los Angeles en mai 1977, les files d'attente aux Etats-Unis pour chaque séance s'étendaient jusque dans les rues, et ce, parfois sur plusieurs "blocs". Tout le monde voulait voir ce "space opera" dont tout le monde parlait. Tout le monde voulait voir ce phénomène qui déchainait la masse. Tout le monde voulait y participer, le vivre et l'intégrer afin de pouvoir dire à son tour : "Moi aussi, j'ai découvert Star Wars au cinéma". Les "vieux" critiques de l'époque étaient dépassés. En France, les remarques dédaigneuses ont fusé afin de tenter futilement de minimiser l'impact gigantesque que le film était en train d'engendrer à l'échelle mondiale (et non pas uniquement dans le milieu hollywoodien) tout en essayant de montrer qu'ils - l'intelligencia - n'étaient pas dupes face à ce gros jouet bruyant rempli d'effets visuels hallucinogènes visant à satisfaire de jeunes dépravés accrocs aux substances LSD.
On peine à présent à le croire, mais le long métrage déchaina les passions. Parce qu'il parvenait à plaire au plus grand nombre grâce à cette épopée à vocation universelle - qui est dorénavant citée comme exemple dans les écoles de scénaristes - Lucas fut la cible de critiques d'une agressivité désolante. En France, le journaliste Ignacio Ramonet fit notamment une analyse idéologique du film en écrivant que :
"seuls les Blancs (et anglophones) parviendront jusqu'au futur ; que [...] les femmes des agriculteurs devront toujours faire la cuisine pour leur mari : [...] que les militaires auront des tentations totalitaires, qu'ils [...] se mettront sous les ordres d'une jeune princesse et que celle-ci, à la fin, distribuera des décorations au cours de grandioses cérémonies de saveur hitlérienne." (1)
De leur côté, les critiques de l'émission "Le Masque et la Plume" se gaussèrent pour la plupart à son sujet en le balayant d'un revers de la main. Peu importe, le succès fut démesuré malgré ces quelques avis mesquins et George Lucas put étendre son odyssée comme il le prévoyait au départ avec Star Wars - L'Empire contre-attaque en 1980 et Star Wars - Le Retour du Jedi en 1983. Le cinéaste originaire de la ville de Modesto développa un puissant empire à l'aide de sa soudaine fortune mirobolante - accumulée notamment par sa judicieuse décision de baisser son salaire pour reçevoir en échange l'intégralité des recettes de la branche des "produits dérivés" alors peu considérée par les grands studios - qui lui assura le contrôle absolu sur ses futures productions et sur l'univers Star Wars dont il se retrouvait être l'unique décisionnaire.
 Néanmoins, ce n'est qu'en 1999 que Lucas revint derrière la caméra, puisqu'il avait préféré assurer le poste de "producteur" lors des deux suites afin de déléguer le fastidieux boulot de la mise en scène tout en gardant le contrôle de la franchise. C'est cette Menace Fantôme qui marquait son retour en tant que cinéaste, ving-deux ans après La Guerre des Etoiles, désormais rebaptisée Star Wars - Episode IV : Un Nouvel Espoir afin de l'inclure logiquement dans le cadre de la trilogie préquelle qu'il préparait et qui se centrait sur la chute du chevalier Jedi Anakin Skywalker - le père de Luke, le héros de la trilogie initiale - qui l'amènera à devenir le vilain Dark Vador. La production de ce premier opus qui devait ouvrir les festivités avant le passage à l'an 2000 fut scrupuleusement suivie par une immense communauté de "fans" grâce à un nouvel outil d'informations en pleine expansion : l'Internet. En effet, La Menace Fantôme fut le premier "blockbuster" dont la fabrication a été particulièrement relayée via la toile et suivie massivement par les internautes-cinéphiles. Néanmoins, tout le monde ne disposait pas encore de cet outil aujourd'hui démocratisé. Pour découvrir les deux bandes annonces du film, les fans devaient parfois aller au cinéma pour la voir. Ainsi, aux Etats-Unis, il n'était pas rare qu'une partie du public quitte la projection d'un film après la diffusion du premier "trailer".
Néanmoins, ce n'est qu'en 1999 que Lucas revint derrière la caméra, puisqu'il avait préféré assurer le poste de "producteur" lors des deux suites afin de déléguer le fastidieux boulot de la mise en scène tout en gardant le contrôle de la franchise. C'est cette Menace Fantôme qui marquait son retour en tant que cinéaste, ving-deux ans après La Guerre des Etoiles, désormais rebaptisée Star Wars - Episode IV : Un Nouvel Espoir afin de l'inclure logiquement dans le cadre de la trilogie préquelle qu'il préparait et qui se centrait sur la chute du chevalier Jedi Anakin Skywalker - le père de Luke, le héros de la trilogie initiale - qui l'amènera à devenir le vilain Dark Vador. La production de ce premier opus qui devait ouvrir les festivités avant le passage à l'an 2000 fut scrupuleusement suivie par une immense communauté de "fans" grâce à un nouvel outil d'informations en pleine expansion : l'Internet. En effet, La Menace Fantôme fut le premier "blockbuster" dont la fabrication a été particulièrement relayée via la toile et suivie massivement par les internautes-cinéphiles. Néanmoins, tout le monde ne disposait pas encore de cet outil aujourd'hui démocratisé. Pour découvrir les deux bandes annonces du film, les fans devaient parfois aller au cinéma pour la voir. Ainsi, aux Etats-Unis, il n'était pas rare qu'une partie du public quitte la projection d'un film après la diffusion du premier "trailer".
Inutile de dire que ce dernier entraina des réactions toutes sauf mesurées, la grande majorité s'extasiant sur les "money shots" tandis qu'une minorité s'inquiétait d'y retrouver des traces des travers que Lucas avait développé : une omniprésence du numérique (cf. la ressortie en 1997 de la trilogie originale au cinéma, dotée de plusieurs hideuses séquences modifiées afin de rendre populaire une saga qui l'était déjà auprès d'une nouvelle génération de gamins), une tendance à l'infantilisation (cf. le tristement fameux "Star Wars Holiday Special" que la société Lucasfilm a maintes fois tenté de supprimer), ou encore un amoindrissement de la portée mythologique de l'intrigue au profit d'un déluge de pirouettes spectaculaires. La sortie du "film-évènement qui allait tout ravager sur son passage et entrainer une nouvelle ère dans l'histoire du cinéma" en calma plus d'un. Entre Jar Jar Binks, l'acteur insipide incarnant Anakin Skywalker, un casting qui déclamait ses lignes avec toute la mauvaise volonté du monde, des personnages aux accents un tantinet racistes, Jar Jar Binks, un rythme mal gêré, d'interminables débats parlementaires pour vaguement tenter d'expliquer un complot corporatiste, une démystification de la Force et Jar Jar Binks, La Menace Fantôme prouvait qu'il n'était absolument pas à la hauteur des épisodes précédents tout en étant aussi désastreux si l'on se contentait de le juger par rapport aux "standards" de l'époque.
 L'Attaque des Clônes en 2002 et, dans une moindre mesure, La Revanche des Siths en 2005 confirmèrent la débacle de l'entreprise. De plus en plus d'effets digitaux pour que Lucas n'ait plus à souffrir des contraintes et des contretemps inhérents à la mise en scène, du "fan service" inutile (Jango Fett, père du tueur à gage Boba Fett si aimé des afficionados de Star Wars, en est l'exemple le plus flagrant), des incohérences à la pelle qui prouvaient que Lucas n'avait jamais eu une ligne directrice précise concernant la prélogie, d'interminables scènes de discussion filmées en champs et contrechamps basiques, un univers de moins en moins original,... Si l'on écarte le miracle qu'a accompli la série animée Clone Wars par Genndy Tartakovsky, seuls le Obi-wan joué par Ewan McGregor et la composition musicale toujours aussi épique de John Williams surnagent aujourd'hui encore de ce carnage intégral. Pourtant, la perspective de poursuivre l'aventure Star Wars malgré un retour aussi calamiteux continua d'enthousiasmer les cinéphiles. Sitôt la prélogie achevée, tout le monde espérait voir se concrétiser cette fameuse troisième trilogie supposée se dérouler après les aventures originales de Luke Skywalker - période qui avait été explorée dans de nombreuses versions parallèles par des artistes divers, formant ce que l'on appelle "l'Univers Etendu".
L'Attaque des Clônes en 2002 et, dans une moindre mesure, La Revanche des Siths en 2005 confirmèrent la débacle de l'entreprise. De plus en plus d'effets digitaux pour que Lucas n'ait plus à souffrir des contraintes et des contretemps inhérents à la mise en scène, du "fan service" inutile (Jango Fett, père du tueur à gage Boba Fett si aimé des afficionados de Star Wars, en est l'exemple le plus flagrant), des incohérences à la pelle qui prouvaient que Lucas n'avait jamais eu une ligne directrice précise concernant la prélogie, d'interminables scènes de discussion filmées en champs et contrechamps basiques, un univers de moins en moins original,... Si l'on écarte le miracle qu'a accompli la série animée Clone Wars par Genndy Tartakovsky, seuls le Obi-wan joué par Ewan McGregor et la composition musicale toujours aussi épique de John Williams surnagent aujourd'hui encore de ce carnage intégral. Pourtant, la perspective de poursuivre l'aventure Star Wars malgré un retour aussi calamiteux continua d'enthousiasmer les cinéphiles. Sitôt la prélogie achevée, tout le monde espérait voir se concrétiser cette fameuse troisième trilogie supposée se dérouler après les aventures originales de Luke Skywalker - période qui avait été explorée dans de nombreuses versions parallèles par des artistes divers, formant ce que l'on appelle "l'Univers Etendu".
Cette arlésienne ne datait pas d'hier mais peu de choses concrêtes avaient été dévoilées sur ce que ces hypothétiques opus VII, VIII et IX étaient supposés raconter depuis que Lucas en avait fait mention dès la fin des années 1970. Indéniablement, Lucas et son équipe de scénaristes avaient réfléchi sur la trame d'épisodes ultérieurs au Retour du Jedi, mais le contenus de ceux-ci semblaient changer diamétralement au fil des années. La mystérieuse genèse de cette troisième trilogie était pour le moins complexe comme en atteste avec moultes détails l'article "La véritable histoire de épisodes VII, VIII et IX". Mais peu-à-peu, les rumeurs se calmèrent lorsque Lucas - après une série de triturations abominables visant à faire correspondre les trois épisodes originaux avec la prélogie - annonça qu'il prenait sa retraite et que, au bout de quelques années, rien de concret n'avait été annoncé pour confirmer la mise en chantier de cette troisième trilogie. C'est alors qu'un communiqué de presse d'une importance certaine dans l'Histoire du cinéma fut publié sur le net le 30 octobre 2012. Personne n'avait rien vu venir. Fait inédit, il n'y avait eu aucune fuite préalable au cours des mois précédents. Malgré l'ampleur de l'information, cette dernière a été révélée officiellement pour la toute première fois sans qu'Internet n'ait pu gâcher la surprise. Le 30 octobre 2012, le monde du cinéma a subi un véritable séisme à cause de cette photo :
L'Internet cessa de tourner. Comment une telle "news" a-t-elle pu échapper aux radars des internautes avant son officialisation ? Ainsi, après avoir lutté pendant trois décennies contre la mainmise des gros studios californiens afin de conserver le contrôle de ses films et de son univers, Lucas cédait toutes ses créations à la plus grosse des "majors" (2). En plus de sa célébrissime filiale d'animation, Disney disposait dorénavant de Pixar, de la majorité des super-héros Marvel, de la franchise Star Wars et de la série Indiana Jones - même si la priorité est donnée au "space opera", nul doute que le "reboot" des aventures de l'archéologue au chapeau est en préparation, le studio n'en ayant pas obtenu les droits d'exploitation à un tel prix pour ne rien en faire. Le prix de l'indépendance de Lucas contribua à la sidération qu'engendra cette nouvelle. Disney dû en effet débourser 4,05 milliars de dollars afin d'acquérir ce que le cinéaste avait mis tant de temps à développer à l'écart des studios : Lucasfilm Ltd, une entreprise pionnière dans le divertissement et l'innovation des technologies cinématographiques fondée à San Francisco dans le "Skywalker Ranch". Disney disposa de plus des filières s'occupant de la production de films "live", de produits dérivés et d'effets visuels - on y retrouve LucasArts, ILM (Industrial Light & Magic) et Skywalker Sound. Afin de sceller la transaction, le cinéaste déclara :
"Durant les 35 dernières années, un de mes plus grand plaisir a été de voir Star Wars passer d'une génération à la suivante. Il est maintenant temps pour moi de transmettre Star Wars à une nouvelle génération de réalisateurs. J'ai toujours cru que Star Wars pourrait me survivre, et je pense qu'il était important de réaliser cette transition de mon vivant. Je suis confiant dans le fait que Lucasfilm, sous la direction de Kathleen Kennedy et ayant une nouvelle maison au sein de l'organisation Disney, et Star Wars continueront de vivre, et fleuriront pour les nombreuses générations à venir. La portée de Disney et son expérience donnent à Lucasfilm l'opportunité de s'ouvrir vers de nouvelles voies dans le cinéma, la télévision, les médias intéractifs, les parcs à thèmes, les spectacles live, et les produits dérivés." (3).
 Le 31 octobre, tout le monde ne parlait plus que de cela : après tant d'années d'incertitude, il y aura bien de nouveaux épisodes Star Wars au cinéma ! Aussitôt, la farandoles des rumeurs commença autour du film "le plus important de ces prochaines années" tandis que le sabotage conscient du John Carter d'Andrew Stanton quelques mois auparavant s'éclaira sous un nouveau jour - adapté des romans d'Edgar Rice Burrough composant ce Cycle de Mars qui servait de source d'inspiration principale à Lucas, le film produit par Disney risquait de lancer une franchise concurrente et trop similaire. La question qui brulait les lèvres était : Star Wars allait-il survivre à ce passage de flambeau ? Cette nouvelle génération de cinéastes réussirait-elle à rendre justice à l'univers de Lucas maintenant que ce dernier a accepté de ne plus être le "Gardien de la Flamme" ? De prime abord, si l'on passait outre l'idée absurde que Star Wars n'appartenait qu'à Lucas - ce qui était faux même lors de la confection de la trilogie initiale au cours de laquelle de nombreux collaborateurs apportèrent leur grain de sel - il y avait plutôt de quoi se réjouir par cette transition, surtout après cette prélogie qui avait montré que Lucas n'était plus que l'ombre de lui-même.
Le 31 octobre, tout le monde ne parlait plus que de cela : après tant d'années d'incertitude, il y aura bien de nouveaux épisodes Star Wars au cinéma ! Aussitôt, la farandoles des rumeurs commença autour du film "le plus important de ces prochaines années" tandis que le sabotage conscient du John Carter d'Andrew Stanton quelques mois auparavant s'éclaira sous un nouveau jour - adapté des romans d'Edgar Rice Burrough composant ce Cycle de Mars qui servait de source d'inspiration principale à Lucas, le film produit par Disney risquait de lancer une franchise concurrente et trop similaire. La question qui brulait les lèvres était : Star Wars allait-il survivre à ce passage de flambeau ? Cette nouvelle génération de cinéastes réussirait-elle à rendre justice à l'univers de Lucas maintenant que ce dernier a accepté de ne plus être le "Gardien de la Flamme" ? De prime abord, si l'on passait outre l'idée absurde que Star Wars n'appartenait qu'à Lucas - ce qui était faux même lors de la confection de la trilogie initiale au cours de laquelle de nombreux collaborateurs apportèrent leur grain de sel - il y avait plutôt de quoi se réjouir par cette transition, surtout après cette prélogie qui avait montré que Lucas n'était plus que l'ombre de lui-même.
L'une des autres raisons était la présence de Kathleen Kennedy à la tête du projet. Cette dernière est l'une des (rares) femmes (très) puissantes à Hollywood et co-dirigeait jusqu'à lors avec son mari The Kennedy/Marshall Company crée en 1992. Cette société de production avait notamment à son actif Sixième Sens de M. Night Shyamalan, Munich et Lincoln de Steven Spielberg ou encore Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. De façon plus large, Kennedy, après avoir débuté comme assistante auprès du scénariste et cinéaste John Milius, s'est imposée peu-à-peu comme une figure de proue du divertissement hollywoodien et a produit la quasi-intégralité des longs métrages de Spielberg depuis les années 1980 (dont E.T. et la trilogie Jurassic Park). Très peu de temps après que le colossal marché ait été conclu, Kennedy révéla qu'elle travaillait depuis plusieurs mois sur le lancement d'une nouvelle trilogie. A partir d'un traitement écrit par Lucas retraçant les grandes lignes qu'étaient supposés suivre les trois prochains épisodes, le scénariste oscarisé Michael Arndt (Little Miss Sunshine, Toy Story 3) fut chargé de composer le script de l'épisode VII.
 Il est difficile de ne pas se perdre dans le flot d'annonces plus ou moins sérieuses qui déferla durant les mois suivants. Le planning de Disney entendait sortir un film Star Wars tous les ans. L'épisode VII devait sortir en mai 2015 (date symbolique) avant d'être repoussé à décembre, l'épisode VIII est prévu en 2017 et l'épisode IX arrivera en 2019. Pour combler les trous, divers films additionnels furent annoncés : des "spin off", soit des longs métrages se déroulant dans le même univers mais se focalisant sur d'autres personnages et d'autres intrigues. Le 5 février 2013, Disney confirma la mise en chantier de ces derniers sans dévoiler sur quoi ils porteraient. Trois seraient officiellement prévus - le premier mis en scène par (le jeune) Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) sortira à l'été 2016 et le second réalisé par (le jeune) Josh Trank (Chronicle, le "reboot" des 4 Fantastiques) sera visible sur les écrans à l'été 2018. Une rumeur apparue en janvier 2013 voulait que Zack Snyder (300, Watchmen, Man of Steel) se charge du troisième, qui reprendrait l'intrigue des Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa (ce dernier ayant été une des grandes influences de la saga) en la transposant dans cette galaxie très, très lointaine. Néanmoins, le bonhomme est rattaché pour une durée indéterminée à Warner avec Man of Steel 2/Superman v. Batman/La Ligue des Justiciers, le commencement (on ne sait plus trop) puis par La Ligue des Justiciers. Des rumeurs récentes et persistantes veulent que ces "spin off" tournent autour de la jeunesse de Han Solo, de Boba Fett et du petit maitre jedi vert Yoda.
Il est difficile de ne pas se perdre dans le flot d'annonces plus ou moins sérieuses qui déferla durant les mois suivants. Le planning de Disney entendait sortir un film Star Wars tous les ans. L'épisode VII devait sortir en mai 2015 (date symbolique) avant d'être repoussé à décembre, l'épisode VIII est prévu en 2017 et l'épisode IX arrivera en 2019. Pour combler les trous, divers films additionnels furent annoncés : des "spin off", soit des longs métrages se déroulant dans le même univers mais se focalisant sur d'autres personnages et d'autres intrigues. Le 5 février 2013, Disney confirma la mise en chantier de ces derniers sans dévoiler sur quoi ils porteraient. Trois seraient officiellement prévus - le premier mis en scène par (le jeune) Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) sortira à l'été 2016 et le second réalisé par (le jeune) Josh Trank (Chronicle, le "reboot" des 4 Fantastiques) sera visible sur les écrans à l'été 2018. Une rumeur apparue en janvier 2013 voulait que Zack Snyder (300, Watchmen, Man of Steel) se charge du troisième, qui reprendrait l'intrigue des Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa (ce dernier ayant été une des grandes influences de la saga) en la transposant dans cette galaxie très, très lointaine. Néanmoins, le bonhomme est rattaché pour une durée indéterminée à Warner avec Man of Steel 2/Superman v. Batman/La Ligue des Justiciers, le commencement (on ne sait plus trop) puis par La Ligue des Justiciers. Des rumeurs récentes et persistantes veulent que ces "spin off" tournent autour de la jeunesse de Han Solo, de Boba Fett et du petit maitre jedi vert Yoda.
Mais qui allait oser s'asseoir sur le siège du réalisateur à la place de Lucas ? Qui aller être assez suicidaire pour s'embarquer dans le projet le plus risqué de ces dernières années - ne bénéficiant pas de la sacro-sainte aura du "Gardien du Temple", le moindre échec risque d'être fatal à la carrière du cinéaste qui aura à affronter les foudres d'une horde composée de quelques millions de fans ? Si les noms de Neill Blomkamp (District 9, Elysium), de Joseph Kosinski (Oblivion, Tron l'héritage produit chez Disney) ou d'Andrew Stanton (un grand nom de Pixar ayant à son actif Le Monde de Némo, Wall-e et John Carter) faisaient rêver les cinéphiles et laissaient entrevoir une variété d'approches stimulantes et variées, ils semblerait qu'ils n'aient jamais été vraiment envisagés. Le premier cinéaste à avoir été approché pour l'épisode VII fut évidemment Steven Spielberg. Ami proche de Lucas et de Kennedy, il a entretenu un certain lien avec la saga : il a failli réaliser Le Retour du Jedi, a participé à l'élaboration du duel final dans La Revanche des Siths et s'est amusé à faire des clins d'oeil malicieux aux films dans E.T.. Mais le bonhomme a roulé sa bosse depuis et il déclina l'offre - il déclarait à cette époque qu'il voulait se mettre "en danger" et que faire des films d'aventure ne l'intéressait plus car il savait les réaliser les yeux fermés.
 De son côté, Guillermo Del Toro (Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim) aurait été judicieusement contacté via son agent mais le cinéaste mexicain a refusé - son planning était déjà tellement chargé qu'il devait abandonner ou déléguer les trois quarts des projets auxquels il se retrouvait attaché. Son ami proche Alfonso Cuaron (Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Les Fils de l'Homme, Gravity) aurait entrepris des discussions mais celles-ci auraient en fait concernées la réalisation d'un épisode ultérieur - si la participation de ce cinéaste génial serait plus que réjouissante, ce dernier souhaite pour l'instant faire une pause après avoir passé quatre années épuisantes sur son propre film spatial. De manière plus surprenante, Ben Affleck (Gone Baby Gone, Argo) aurait aussi été courtisé tandis que Matthew Vaughn (Layer Cake, Kick-ass, X-men : le commencement) aurait été très proche de décrocher le poste - il aurait notamment conseillé d'engager Chloe Moretz (Kick-ass, Laisse-moi entrer) pour l'un des rôles principaux. De tous ces noms, le candidat le plus sérieux fut Brad Bird. Le réalisateur du Géant de fer, des Indestructibles, de Ratatouille et de Mission Impossible : Protocole Fantôme a déclaré que Lucas et Kennedy l'avaient rencontré en personne mais qu'il avait décliné l'offre pour se consacrer pleinement sur son prochain film intitulé Tomorrowland.
De son côté, Guillermo Del Toro (Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim) aurait été judicieusement contacté via son agent mais le cinéaste mexicain a refusé - son planning était déjà tellement chargé qu'il devait abandonner ou déléguer les trois quarts des projets auxquels il se retrouvait attaché. Son ami proche Alfonso Cuaron (Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Les Fils de l'Homme, Gravity) aurait entrepris des discussions mais celles-ci auraient en fait concernées la réalisation d'un épisode ultérieur - si la participation de ce cinéaste génial serait plus que réjouissante, ce dernier souhaite pour l'instant faire une pause après avoir passé quatre années épuisantes sur son propre film spatial. De manière plus surprenante, Ben Affleck (Gone Baby Gone, Argo) aurait aussi été courtisé tandis que Matthew Vaughn (Layer Cake, Kick-ass, X-men : le commencement) aurait été très proche de décrocher le poste - il aurait notamment conseillé d'engager Chloe Moretz (Kick-ass, Laisse-moi entrer) pour l'un des rôles principaux. De tous ces noms, le candidat le plus sérieux fut Brad Bird. Le réalisateur du Géant de fer, des Indestructibles, de Ratatouille et de Mission Impossible : Protocole Fantôme a déclaré que Lucas et Kennedy l'avaient rencontré en personne mais qu'il avait décliné l'offre pour se consacrer pleinement sur son prochain film intitulé Tomorrowland.
Ce rendez-vous manqué est frustrant tant Bird est un artiste d'une grande intelligence, capable d'être aussi à l'aise avec le drame, l'humour et l'action. Il a l'expérience des grandes productions et il sait comment s'adresser à un jeune public tout en maniant des références et des thématiques susceptibles de parler aux adultes. Ne perdons pas espoir pour un futur épisode (4) car son "remplaçant" ne lui est pas étranger et a participé à l'élaboration de son film d'espionnage avec Tom Cruise. Le 25 janvier 2013, nouveau coup de théâtre : LucasFilm annonça que J.J. Abrams sera le réalisateur de Star Wars - Episode VII. "Golden Boy" de Hollywood qui rêve d'être Spielberg sans jamais parvenir à la cheville de son modèle, Abrams a débuté en tant que producteur et scénariste à la télévision (Lost notamment) avant de faire ses premier pas en tant que metteur en scène de cinéma avec Mission : Impossible 3 (il avait au préalable co-écrit Armaggedon de Michael Bay et rédigé une version de Superman lorsque la Warner tentait de ressuciter la franchise à la fin des années 1990). Grace à son succès et à sa popularité grandissante, ce "geek" portant toujours des lunettes, une casquette, un jean et des baskets (voyez que la tentative d'imitation du cinéaste des Dents de la Mer est d'une grande subtilité et ne se limite pas qu'à ses films - il ne manque plus que la barbe) eut ensuite pour tâche de ressuciter la série Star Trek sur le grand écran après moultes films de qualité décroissante.
 Ainsi, grâce à un choix d'une franche originalité, les deux séries de S.F. concurrentes (et supposées très opposées) furent confiées au même homme. Sachant que Abrams, pour faire renaître la série de Gene Roddenberry, a pompé Star Wars, on peut considérer et craindre que son Episode VII ne soit pas très différent de son Star Trek et de sa suite pas super réjouissante Star Trek - Into Darkness. Pour rappeler la méfiance qu'inspire Abrams en ces lieux, je me contenterais de citer ce que j'avais écrit à son sujet lors de la critique de son précédent film :
Ainsi, grâce à un choix d'une franche originalité, les deux séries de S.F. concurrentes (et supposées très opposées) furent confiées au même homme. Sachant que Abrams, pour faire renaître la série de Gene Roddenberry, a pompé Star Wars, on peut considérer et craindre que son Episode VII ne soit pas très différent de son Star Trek et de sa suite pas super réjouissante Star Trek - Into Darkness. Pour rappeler la méfiance qu'inspire Abrams en ces lieux, je me contenterais de citer ce que j'avais écrit à son sujet lors de la critique de son précédent film :
"Certes, J.J. Abrams vient lui-aussi [à l'instar de son mentor Spielberg] de la télévision [...]. Mais son embrayage dans le domaine du cinéma est moins jubilatoire et original : la suite d'une série (Mission : Impossible 3), le "reboot" d'une vieille série (Star Trek), le "remake" masqué d'un classique de la S.F. sorti en 1982 (Super 8, vendu comme un projet original alors qu'il repompait intégralement une imagerie popularisée par le studio Amblin tout en la mâtinant d'un peu de Jurassic Park), et maintenant la suite du "reboot" de la vieille série (Star Trek - Into Darkness) avant la suite-"reboot" d'une énième franchise ne lui appartenant pas."
Le bonhomme n'est donc pas le plus imaginatif - ou le moins récycleur/plagieur - des cinéastes et sa personnalité est très peu marquée malgré l'insistance des "Cahiers du Cinéma" à nous le faire passer pour le meilleur "entertainer" dont Hollywood dispose à l'heure actuelle. Néanmoins, si le bougre n'est pas un grand réalisateur, il est un publicitaire hors pair aux méthodes parfaitement rodées. Le point de départ de ses films est toujours alléchant, le tournage est top secret pour intriguer les "geeks" avant de les exciter par quelques photos soit-disant "volées", quelques "teasers" font monter la sauce, on ment sur des points de détail pour faire croire que rien n'a été éventé. L'effet est que les cinéphiles se mettent à élaborer toute une intrigue et une mythologie "parallèles" à celles du film réel qu'ils n'ont pas encore vu (5). Le buzz monte à son paroxysme alors que J.J. fait le tour des conventions de "fanboys" pour leur dévoiler un morceau exclusif de la chose. Après de si longs préliminaires vient l'extase tant attendue avec la projection. Et lors du générique de fin, le spectateur plongé dans un état post-coïtal réalise avec déception que ça ne valait pas tout ce tintamarre. Comme pour confirmer la mauvaise tournure que venait de prendre le projet, Ardnt fut mystérieusement remplacé par Abrams et Lawrence Kasdan - une des nombreuses cautions artistiques visant à satisfaire et à aveugler les puristes. Ce dernier est le scénariste de L'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi (ainsi que des Aventuriers de l'Arche Perdu) ; il bénéficie donc d'un certain "background" bien qu'il n'ait rien fait du même niveau depuis trente ans. Et Abrams est loin d'avoir brillé par la tenue de ses précédents scénarii. Simple réécriture ou refonte totale du projet ? On l'ignore mais cela a été suffisamment important pour repousser de six mois la sortie du film (Disney refuse d'accorder un délai supplémentaire). Plus d'un an après, la production derrière l'Episode VII révéla enfin son casting, marquant le "top départ" du tournage et de l'hystérie qui va durer sans discontinuer jusqu'en décembre 2015 :
La photo officielle du casting prise lors d'une lecture faite aux studios Pinewood, Londres, le 29 avril 2014. J.J Abrams y est entouré de (dans le sens des aiguilles d'une montre) Harrison Ford (HAN SOLO), Daisy Ridley, Carrie Fisher (LA PRINCESSE LEIA), Peter Mayhew (CHEWBACCA), le producteur Bryan Burk, Kathleen Kennedy, Domhnall Gleeson (Anna Karenine), Anthony Daniels (C3PO), Mark Hamill (LUKE SKYWALKER), Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux), Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis), John Boyega (Attack the Block), Adam Driver (Lincoln) et de Lawrence Kasdan.
A la liste d'acteurs sus-mentionnés s'ajoutent Max Von Sydow (L'Exorciste), Gwendoline Christie (la série Game of Thrones), l'oscarisée Lupita Nyong'o (12 Years a Slave) et a priori David Oyelowo (Jack Reacher). Si l'on s'en fie à l'âge et à la couleur de peau de ces deux derniers, on peut conclure qu'ils incarneront sûrement la mère et le père du personnage joué par Boyega. Ajoutons aussi qu'il s'agirait de "méchants" - vous voyez venir l'intrigue très originale dans la saga du jeune héros contraint d'affronter ses propres parents ? Parmi les recalés, citons Gary Oldman, Michael Fassbender, Saoirse Ronan (malheureusement), Zac Efron, Benedict Cumberbatch (malheureusement, bis) ou encore Judie Dench. Le casting rassure autant qu'il inquiète. Le bon coté est que ces acteurs sont d'excellents comédiens capables de rendre pleinement justice aux dialogues si particuliers de ce "space opera". Le retour des anciens est risqué, mais il semblerait qu'après un régime draconien Mark Hamill et Carrie Fisher semblent à peu près prêt à rendre justice à la version âgée de leurs personnages.
Néanmoins, attention à l'excès de nostalgie - probablement la plus grande crainte que l'on puisse avoir au sujet d'Abrams qui se complait bien trop souvent à faire des clins d'oeils et à récycler ce qui a été fait auparavant ! De plus, la mise en avant de Harrison Ford au détriment de Hamill (le premier étant beaucoup plus célèbre et son personnage étant beaucoup plus mémorable) indique que Star Wars ne suivra plus vraiment la lignée des Skywalker. Pour ne rien arranger, Ford, dont le rôle dans l'épisode VII a été décrit comme "gigantesque" - nul doute que la star devrait voir son ancien souhait être réalisé à la fin du film, vient de se blesser et est indisponible pendant huit semaines. Et devait-on vraiment reprendre le diminué Mayhew pour Chewbacca ainsi que Kenny Baker pour le droïde R2-D2, à l'heure où l'on peut éviter à un nain de se retrouver enfermer dans un caisson afin de controler le petit droïde, pour plaire à tout prix aux fans intégristes ?
Dans le cas des "nouveaux", on peut être légèrement perplexe. Qui parie qu'Oscar Isaac incarnera une sorte d'antihéros cynique visant à remplacer Han Solo ? Qui parie que le pro de la performance capture Andy Serkis interprêtera une créature alien chargée de se substituer à un Chewbacca grabataire ? Von Sydow jouera-t-il le fantôme d'Obi-wan Kenobi ? Les espoirs de nouveauté - loin d'être garantis - sont donc à placer dans le trio de héros principaux : Boyega (surement le nouveau "Luke"), Ridley (vu sa position sur la photo, probablement la fille de Solo et de Leia, et donc la remplaçante de cette dernière) et vraisemblablement Dominic Gleeson (à moins qu'il ne s'agisse d'Isaac chargé de se substituer à Solo). Abrams osera-t-il s'aventurer dans de nouveaux horizons ? Rien n'est moins sûr quand on se rappelle ses deux Star Trek complètement référenciels. Pour confirmer cette déférence paralysante, John Williams a été engagé pour les trois films au détriment d'un peu de sang neuf (au hasard, le tout indiqué Michael Giacchino). On peut craindre, vu l'âge du géant de la B.O. de films, qu'il ne parvienne pas à finir la trilogie, ce qui pourrait s'avérer dommageable quant à l'homogénéité musicale de l'ensemble. Evidemment, l'adoré Faucon Millenium sera là.
Et depuis quelques semaines, les effets d'annonces se multiplient pour donner aux fans ce qu'ils réclament (cette servitude envers eux sera-t-elle bénéfique au film ? Rien n'est moins sûr). Tournage en 35mm évidemment, localisé à Londres comme lors de la première Guerre des Etoiles, avec le retour d'une partie de l'ancienne équipe technique tandis qu'une part de l'intrigue se déroulera sur Tatooine (à croire qu'il n'y a que cette planète dans la galaxie Star Wars). Une longue série de photos "volées" est apparue dernièrement sur le net. Outre le fait que l'on puisse douter du caractère clandestin de ces images - comme si le tournage d'un film évènementiel était aussi détendu qu'un Club Med ! - celles-ci dévoilent plein de décors, d'accessoires et de bébêtes "en dur" afin de faire croire aux fans qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets numériques (vous voulez dire comme lorsqu'on nous l'avait promis durant la production d'Indiana Jones et le crâne de cristal ?). Au passage, l'une d'entre elles prouve déjà qu'il y aurait bien un récyclage des anciens "concept arts" non employés par le film de 1977 (cf. cette sublime image de Ralph McQuarrie). Tout va bien : en 2014, on s'apprête à filmer un long métrage exactement comme en 1977, et tout ça pour votre bon plaisir ! Pendant ce temps-là, une rumeur persistante annonce que le costume de Boba Fett se promènerait sur le plateau - cette résurrection collerait idéalement avec ce supposé "spin-off" qui lui serait dédié.
On le sait, la mode hollwoodienne est à la nostalgie. Qu'il est aisé d'obtenir un succès en titillant la fibre sensible des cinéphiles : les plus vieux voudraient revivre cet émerveillement de leur jeunesse tandis que les plus jeunes souhaitent avoir l'opportunité de voir ces classiques - ou un "ersatz" - sur un grand écran et non plus en DVD. Néanmoins, combien de ces retours opportunistes n'ont pas été de véritables gueules de bois ? La leçon que nous ont donné Indiana Jones 4, Prometheus, Die Hard 4, Predators, les "remakes" de Total Recall, Robocop, The Thing, etc,... ne nous ont rien appris ? Cela est voué à l'échec car un film est TOUJOURS représentatif de son époque. Et la nôtre n'est pas assez courageuse pour inventer ses propres mythologies. Alors on pille (et non "s'inspire") d'anciennes oeuvres en croyant qu'il suffit de quelques clins d'oeils malicieux envers leurs éléments les plus caractéristiques pour que cela suffise à obtenir la même "essence". Combien de temps faudra-t-il encore pour que les cinéphiles comprennent que la nostalgie est un dangereux leurre commercial - car ce n'est évidemment pas par "nostalgie" que Disney a lancé une troisième trilogie Star Wars ?
Si on peut laisser le bénéfice du doute à Abrams qui peut nous réserver un sursaut en se retrouvant à la tête de son oeuvre préférée - si un bon réalisateur peut faire un mauvais film, pourquoi un cinéaste quelconque ne pourrait pas avoir un éclair de génie (Jason Reitman et Doug Liman nous l'ont prouvé avec leurs derniers films) ? - il est quand même difficile de jouer les impatients devant cette production aux airs de déjà-vu qui seront sans nul doute confirmés lors de la diffusion des premières photos officielles, des trente "trailers" et des cinquantes posters qui seront tous décortiqués plus que de raison. Si on a le droit d'attendre ce Star Wars VII, peut-on quand même s'avouer méfiant devant autant de bonnes intentions qui ne peuvent être complètement honnêtes ? Peut-on être un peu agacé par le fait que l'on nous concocte une soupe à laquelle on a déjà gouté ? Peut-on enfin surtout dire qu'un Star Wars devrait être infiniment plus qu'un divertissement "fun", que l'on consomme et que l'on oublie aussitôt à l'instar de Star Trek : Into Darkness ? Ou qu'un hommage déférent et frileux car paralysé par le gigantisme de ce qu'il admire ? Et que tout ce que l'on nous a annoncé jusqu'à présent tend pour l'instant à confirmer ces deux approches ? C'est vraiment cela que tout cinéphile qui a grandi avec les oeuvres de Lucas et de Spielberg se doit d'attendre avec impatience ? Doit-on se réjouir qu'en termes de grandes aventures spectaculaires au cinéma, on ne nous offrira jusqu'en 2020 rien d'autre que du (non)super-héros Marvel/D.C. et du Star Wars réchauffé ? Pendant ce temps, personne ne parle de Tomorrowland de Bird, tout comme personne ne s'était vraiment intéressé à la production de Edge of Tomorrow, d'Avatar et de Gravity. Et alors qu'un abject Iron Man 3 et qu'un pathétique World War Z cartonnent, seule une minorité défend un Pacific Rim, John Carter ou un Lone Ranger. Combien de Terminator Génésis et Jurassic World faudra-t-il pour que l'on se décide à convaincre - nous, spectateur - les producteurs de lâcher ces sublimes licences "d'un autre temps" pour inventer celles d'aujourd'hui ?
_ _ _ _ _
(1) Ignacio Ramonet, "La Guerre des étoiles ou l'Amérique réconciliée avec sa technologie", Libération, n°1157, paru le 19 octobre 1977, (p.14)
(2) L'article de Rafik Djoumi, intitulé "Lucasfilm et Disney : la chute de la République" et publié sur le site "Capture Mag" le 5 novembre 2012, revient en détail sur la terrible symbolique et les immenses implications de cet accord.
(3) L'article "Le rachat de LucasFilm par Disney" publié sur le site "Starwars Universe" lors du dossier "STAR WARS VII - EN ATTENDANT LE RETOUR". Celui-ci revient précisément sur les détails de la transaction et les ambitions affichées par les deux partis.
(4) A peine 48h après la publication de mon article, Disney/Lucasfilm annonçait que l'excellent Rian Johnson (quelques-uns des meilleurs épisodes de Breaking Bad, Looper) écrira et réalisera l'épisode VIII, tout en fournissant un traitement détaillé pour l'épisode IX. Comme quoi, alors que je mettais en doute la démarche et les choix du studio Mickey, ce dernier se charge de me remettre à ma place.
(5) On peut prendre comme exemple la manière avec laquelle Abrams s'est échiné à masquer l'identité du méchant de Star Trek - Into Darkness interprété par Benedict Cumberbatch et qui avait été éventé des mois à l'avance par des "geeks" qui, réalisant lors de la sortie du film qu'ils avaient raison, exprimèrent un réel mécontentement envers le réalisateur qui avait persisté à leur mentir pour quelque chose d'absolument évident. Conscient de son goût exagéré pour le mystère à tout prix, Abrams en plaisanta même à dessein dans le cadre de la promo lors d'une émission de Conan O'Brien. Inutile de préciser qu'il s'est exactement passé ce que O'Brien et Abrams "moquent".










 L'année d'après, il tient l'un des rôles principaux dans 7h58 ce samedi-là, le film testament du cinéaste de génie Sydney Lumet (Douze Hommes en colère, Serpico, Un après-midi de chien,...), véritable icône de l'époque du Nouvel Hollywood, avant d'enchainer avec La Guerre selon Charie Wilson de Mike Nichols (Le Lauréat), soit une autre immense figure de cette même période. Parmi ses longs métrages plus récents, on peut mentionner Synecdoque, New York de Charlie Kaufman en 2008, la très jouissive comédie "brtish" Good Morning England de Richard Curtis en 2009 dans un mémorable personnade d'animateur radiophonique américain surnommé le "Comte", Les Marches du pouvoir de George Clooney et Le Stratège de Miller en 2011. Quelques mois plus tard, il retrouve son comparse Paul Thomas Anderson qui va lui offrir son personnage le plus emblématique dans The Master. Injustement éclipsé par le retour cabotin de son comparse Joaquim Phoenix, sa prestation en gourou manipulateur et pathétique est de loin la plus subtile et la plus fascinante qu'il ait pu livrer à ce jour ("L'Ecran Masqué" l'avait mentionné il y a un mois dans son
L'année d'après, il tient l'un des rôles principaux dans 7h58 ce samedi-là, le film testament du cinéaste de génie Sydney Lumet (Douze Hommes en colère, Serpico, Un après-midi de chien,...), véritable icône de l'époque du Nouvel Hollywood, avant d'enchainer avec La Guerre selon Charie Wilson de Mike Nichols (Le Lauréat), soit une autre immense figure de cette même période. Parmi ses longs métrages plus récents, on peut mentionner Synecdoque, New York de Charlie Kaufman en 2008, la très jouissive comédie "brtish" Good Morning England de Richard Curtis en 2009 dans un mémorable personnade d'animateur radiophonique américain surnommé le "Comte", Les Marches du pouvoir de George Clooney et Le Stratège de Miller en 2011. Quelques mois plus tard, il retrouve son comparse Paul Thomas Anderson qui va lui offrir son personnage le plus emblématique dans The Master. Injustement éclipsé par le retour cabotin de son comparse Joaquim Phoenix, sa prestation en gourou manipulateur et pathétique est de loin la plus subtile et la plus fascinante qu'il ait pu livrer à ce jour ("L'Ecran Masqué" l'avait mentionné il y a un mois dans son  Pourtant, nous ne saurons pas ce que Hoffman aurait accompli ces prochaines années. Nous ne pouvons plus qu'imaginer les rôles qu'il aurait pu avoir et dans lesquels il aurait brillé, car Hoffman est décédé des suites d'une overdose, à New York, ce 2 février dernier. Une nouvelle inattendue, bien que l'acteur avait révélé avoir souffert d'addictions pendant ses jeunes années. En l'état, sa dernière apparition s'est faite dans le blockbuster Hunger Games 2 de Francis Lawrence que la critique a, dans l'ensemble, désignée comme assez "inconsistante", surtout par rapport à son parcours et à l'implication du reste du casting. Mais ce ne sera heureusement pas sa dernière partition et l'acteur ne devrait pas conclure sa trop brève carrière sur une note en demi-teinte. Cette année, il reviendra sur "Terre" le temps d'un film : Un homme très recherché d'Anton Corbjin, dont les futures projections risquent de prendre une sinistre résonnance à présent.
Pourtant, nous ne saurons pas ce que Hoffman aurait accompli ces prochaines années. Nous ne pouvons plus qu'imaginer les rôles qu'il aurait pu avoir et dans lesquels il aurait brillé, car Hoffman est décédé des suites d'une overdose, à New York, ce 2 février dernier. Une nouvelle inattendue, bien que l'acteur avait révélé avoir souffert d'addictions pendant ses jeunes années. En l'état, sa dernière apparition s'est faite dans le blockbuster Hunger Games 2 de Francis Lawrence que la critique a, dans l'ensemble, désignée comme assez "inconsistante", surtout par rapport à son parcours et à l'implication du reste du casting. Mais ce ne sera heureusement pas sa dernière partition et l'acteur ne devrait pas conclure sa trop brève carrière sur une note en demi-teinte. Cette année, il reviendra sur "Terre" le temps d'un film : Un homme très recherché d'Anton Corbjin, dont les futures projections risquent de prendre une sinistre résonnance à présent. Il y a peu, la dernière véritable tragédie dans l'Histoire du Cinéma était, non pas la 3D, l'arrivée du numérique ou la soit-disant soudaine omniprésence des reboot-remakes comme le sous-entendraient les pseudos-admirateurs du 7ème art, mais la mort trop précoce du génialissime réalisateur de films d'animation japonais Satoshi Kon (Perfect Blue, Millenium Actress, Paprika). La mort beaucoup trop précoce du "Maître" Philip Seymour Hoffman, à 46 ans et laissant trois enfants, vient malheureusement de lui succéder.
Il y a peu, la dernière véritable tragédie dans l'Histoire du Cinéma était, non pas la 3D, l'arrivée du numérique ou la soit-disant soudaine omniprésence des reboot-remakes comme le sous-entendraient les pseudos-admirateurs du 7ème art, mais la mort trop précoce du génialissime réalisateur de films d'animation japonais Satoshi Kon (Perfect Blue, Millenium Actress, Paprika). La mort beaucoup trop précoce du "Maître" Philip Seymour Hoffman, à 46 ans et laissant trois enfants, vient malheureusement de lui succéder. 
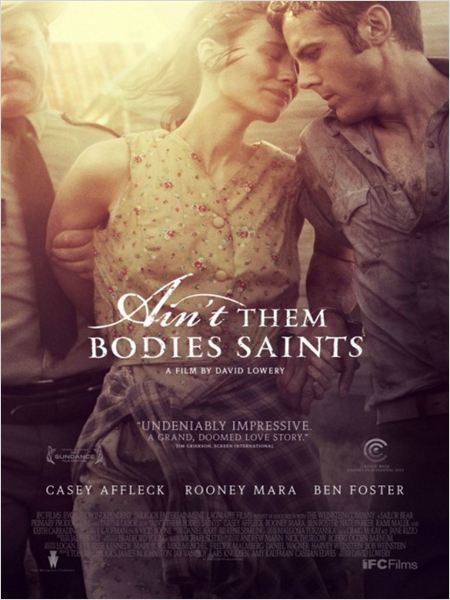
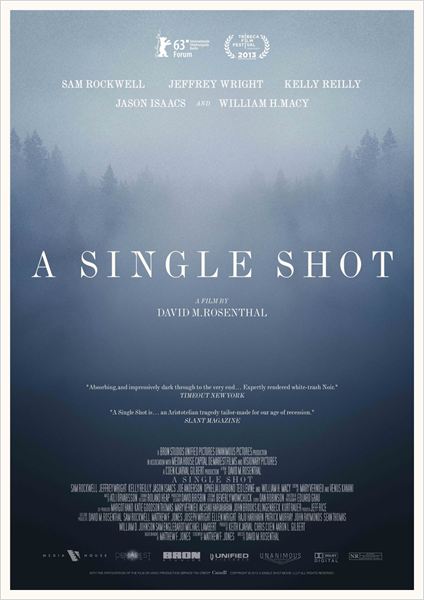
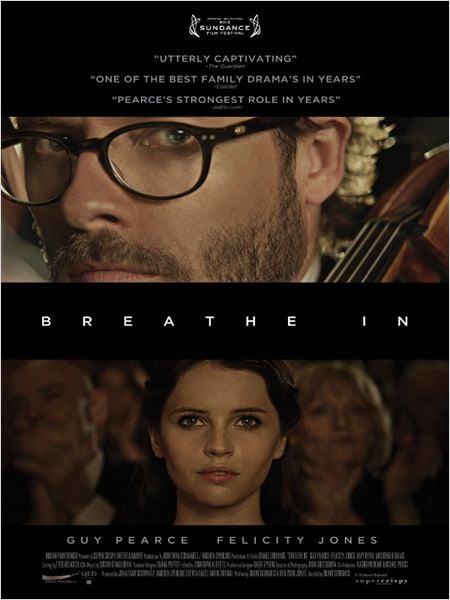
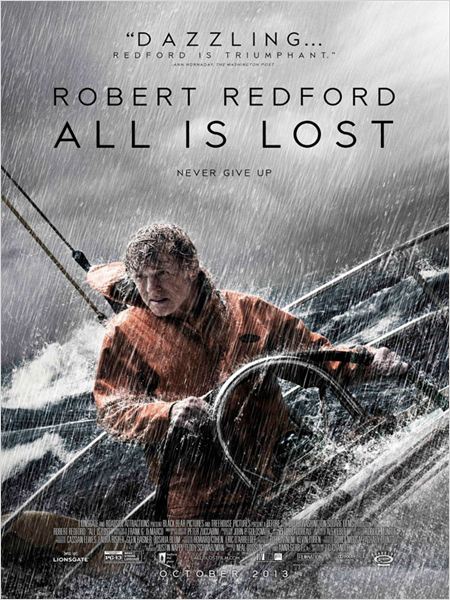

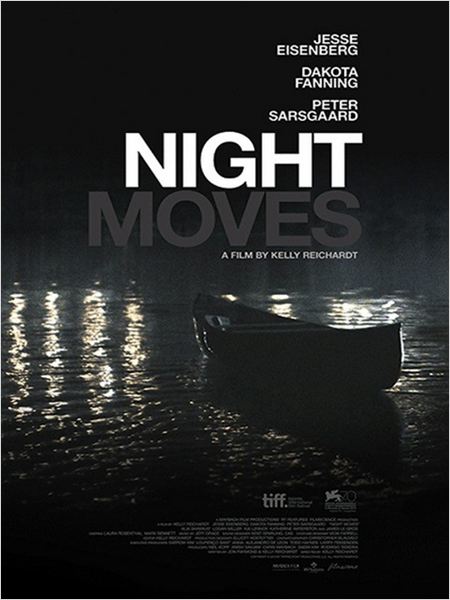


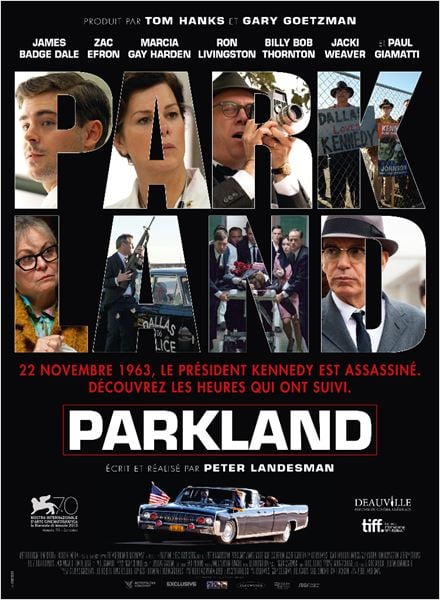




















 Consternation d’abord au sujet du Francine de Brian M. Cassidy et de Melanie Shatzky. Racontant l’histoire archi-revue d’une femme sortant de prison et peinant à se réinsérer, le long métrage se la joue naturaliste et réaliste. Par conséquent, on se farcit des plans séquences en caméra portée ne se terminant jamais et suivant bêtement les personnages de dos en train de marcher, des scènes qui durent à chaque fois trente secondes de trop, des saynètes quotidiennes à l’intérêt extrêmement limité… Francine est doté d’un scénario écologique ne devant pas excéder dix pages et ces dernières ont été indéfiniment étirées sur une heure et quart de film d’une vacuité sans borne. Un long métrage qui peine tellement à émouvoir le spectateur qu’il utilise des moyens tire-larmes extrêmement grossiers pour le faire chialer (l’euthanasie d’un chien en temps réel entre autres). Outre Melissa Léo qui tire la tronche, l’actrice étant l’unique raison de la sélection de ce film au Festival de Deauville, Francine est d’une infinie laideur que ce soit en termes de cadres, de luminosité ou de définition d’image (le directeur de la photographie ne s’est même pas embêté à faire le point sur certains plans). Au final, du vent sans aucun intérêt qui a été copieusement hué lors de sa première au Festival. Du pur amateurisme [sortie indéterminée].
Consternation d’abord au sujet du Francine de Brian M. Cassidy et de Melanie Shatzky. Racontant l’histoire archi-revue d’une femme sortant de prison et peinant à se réinsérer, le long métrage se la joue naturaliste et réaliste. Par conséquent, on se farcit des plans séquences en caméra portée ne se terminant jamais et suivant bêtement les personnages de dos en train de marcher, des scènes qui durent à chaque fois trente secondes de trop, des saynètes quotidiennes à l’intérêt extrêmement limité… Francine est doté d’un scénario écologique ne devant pas excéder dix pages et ces dernières ont été indéfiniment étirées sur une heure et quart de film d’une vacuité sans borne. Un long métrage qui peine tellement à émouvoir le spectateur qu’il utilise des moyens tire-larmes extrêmement grossiers pour le faire chialer (l’euthanasie d’un chien en temps réel entre autres). Outre Melissa Léo qui tire la tronche, l’actrice étant l’unique raison de la sélection de ce film au Festival de Deauville, Francine est d’une infinie laideur que ce soit en termes de cadres, de luminosité ou de définition d’image (le directeur de la photographie ne s’est même pas embêté à faire le point sur certains plans). Au final, du vent sans aucun intérêt qui a été copieusement hué lors de sa première au Festival. Du pur amateurisme [sortie indéterminée].  Una Noche
Una Noche  Déception aussi avec le Wrong de Quentin Dupieux. Partant d’un postulat assez amusant (montrer un monde où tout est « wrong », c’est-à-dire « anormal »), le long métrage de Dupieux est le cas typique du film qui aurait gagné à n’être qu’un moyen métrage. Car au bout d’une demi-heure, il faut se rendre à l’évidence : le concept finit par s’épuiser. Les gags deviennent répétitifs et l’anormalité devient normale tant elle finie par être attendue et prévisible. Dupieux fait l’erreur de ne pas caser un important évènement dont la normalité aurait paradoxalement détonné avec cet univers. Le normal deviendrait alors anormal. Pas de décalage ici. Ou beaucoup trop justement. Clairement, le long métrage est assez agréable à l’œil mais il est d’une terrible froideur en n’hésitant pas à refuser que le spectateur parvienne à s’y immerger. Un grand nombre de scènes apparaissent gratuitement, sans aucun but narratif comme la drôle mais affreusement longue et inutile séquence de l’étude de la crotte. Wrong apparait malheureusement comme un produit destiné à être « hype » mais qui est surtout d’une vacuité infinie. Amusant vingt minutes, gonflant au bout d’une heure. Si l’on était un peu méchant, on pourrait dire que l’ouverture et la fermeture du film (un homme qui chie longuement et une voiture roulant vers nulle part) sont de parfaites notes d’intention [05.09.2012].
Déception aussi avec le Wrong de Quentin Dupieux. Partant d’un postulat assez amusant (montrer un monde où tout est « wrong », c’est-à-dire « anormal »), le long métrage de Dupieux est le cas typique du film qui aurait gagné à n’être qu’un moyen métrage. Car au bout d’une demi-heure, il faut se rendre à l’évidence : le concept finit par s’épuiser. Les gags deviennent répétitifs et l’anormalité devient normale tant elle finie par être attendue et prévisible. Dupieux fait l’erreur de ne pas caser un important évènement dont la normalité aurait paradoxalement détonné avec cet univers. Le normal deviendrait alors anormal. Pas de décalage ici. Ou beaucoup trop justement. Clairement, le long métrage est assez agréable à l’œil mais il est d’une terrible froideur en n’hésitant pas à refuser que le spectateur parvienne à s’y immerger. Un grand nombre de scènes apparaissent gratuitement, sans aucun but narratif comme la drôle mais affreusement longue et inutile séquence de l’étude de la crotte. Wrong apparait malheureusement comme un produit destiné à être « hype » mais qui est surtout d’une vacuité infinie. Amusant vingt minutes, gonflant au bout d’une heure. Si l’on était un peu méchant, on pourrait dire que l’ouverture et la fermeture du film (un homme qui chie longuement et une voiture roulant vers nulle part) sont de parfaites notes d’intention [05.09.2012].  Compliance
Compliance The We and the I
The We and the I  Des films clairement imparfaits, il y en a eu en compétition. Après tout, quoi de plus normal lorsqu’il s’agit pour la plupart de premiers voire de seconds films ? Si dans leurs cas on est loin d’atteindre Il était une fois dans l’Ouest, ils sont néanmoins largement supérieurs à un long métrage vide tel Francine. C’est le cas de Gimme the Loot notamment. Le film d’Adam Leon n’est clairement pas dénué de qualités. La première, et non la moindre, est de dévoiler un univers pas forcément très familier du public, bien que leurs œuvres soient régulièrement visibles aux yeux de tous : celui des « graffeurs ». Là encore il s’agit d’un long métrage relatant un passage à l’acte. Les deux héros, une jeune fille nommée Sofia (Tashiana Washington) et un jeune homme s’appelant Malcom (Ty Hickson), décident de recouvrir de graffiti la pomme géante du Shea Stadium afin de montrer au quartier qui sont les meilleurs graffeurs. La mise en scène se fait cette fois plus réaliste avec l’aide d’une caméra portée et de dialogues en partie improvisés. A ce titre, les deux acteurs amateurs principaux s’en sortent clairement avec les honneurs. Mais là encore le film s’étire trop en longueur sur les préparatifs sans cesse repoussés ou entravés. Une sous-intrigue intéressante, quoique traitée avec un peu de lourdeur, voit la confrontation entre le jeune héros noir et une charmante fille à papa friquée qui ne se révèlera pas si adorable que ça. Du film, on retiendra une intéressante scène de tentative d’effraction, à la fois tendue et comique. Pour le reste, le véritable nœud du film, à savoir la relation entre les deux compères qui est un peu plus que strictement professionnelle et amicale, est un peu trop laissé de côté pour revenir comme un cheveu sur la soupe vers la fin. Et comme pour Una Noche et Booster, que nous verrons ensuite, la conclusion de Gimme the Loot risque bien de décevoir les spectateurs qui auront la désagréable impression d’avoir eu beaucoup de bruits et d’images pour pas grand-chose [02.01.2013].
Des films clairement imparfaits, il y en a eu en compétition. Après tout, quoi de plus normal lorsqu’il s’agit pour la plupart de premiers voire de seconds films ? Si dans leurs cas on est loin d’atteindre Il était une fois dans l’Ouest, ils sont néanmoins largement supérieurs à un long métrage vide tel Francine. C’est le cas de Gimme the Loot notamment. Le film d’Adam Leon n’est clairement pas dénué de qualités. La première, et non la moindre, est de dévoiler un univers pas forcément très familier du public, bien que leurs œuvres soient régulièrement visibles aux yeux de tous : celui des « graffeurs ». Là encore il s’agit d’un long métrage relatant un passage à l’acte. Les deux héros, une jeune fille nommée Sofia (Tashiana Washington) et un jeune homme s’appelant Malcom (Ty Hickson), décident de recouvrir de graffiti la pomme géante du Shea Stadium afin de montrer au quartier qui sont les meilleurs graffeurs. La mise en scène se fait cette fois plus réaliste avec l’aide d’une caméra portée et de dialogues en partie improvisés. A ce titre, les deux acteurs amateurs principaux s’en sortent clairement avec les honneurs. Mais là encore le film s’étire trop en longueur sur les préparatifs sans cesse repoussés ou entravés. Une sous-intrigue intéressante, quoique traitée avec un peu de lourdeur, voit la confrontation entre le jeune héros noir et une charmante fille à papa friquée qui ne se révèlera pas si adorable que ça. Du film, on retiendra une intéressante scène de tentative d’effraction, à la fois tendue et comique. Pour le reste, le véritable nœud du film, à savoir la relation entre les deux compères qui est un peu plus que strictement professionnelle et amicale, est un peu trop laissé de côté pour revenir comme un cheveu sur la soupe vers la fin. Et comme pour Una Noche et Booster, que nous verrons ensuite, la conclusion de Gimme the Loot risque bien de décevoir les spectateurs qui auront la désagréable impression d’avoir eu beaucoup de bruits et d’images pour pas grand-chose [02.01.2013].  Inabouti pourrait aussi être le parfait qualificatif de Booster. Lui-aussi part d’un pitch relativement simple : un homme se retrouve obligé de faire une série de cambriolages afin d’innocenter son frère coupable qui croupit en prison. Comme Una Noche et Gimme the Loot, le film de Matt Ruskin est une œuvre relatant la préparation d’un acte qui n’interviendra qu’à la toute fin du long métrage. On peut donc aussi considérer qu’au même titre que l’œuvre de Lucy Mulloy, Booster s’arrête un peu là où il aurait dû commencer. Mais ce dernier s’élève un peu plus grâce à une forme plutôt agréable à suivre. On reconnaitra clairement l’influence de Michael Mann et de ses nombreux ersatz dans cette manière de filmer un environnement urbain ou de décrire comment le déterminisme social (le héros fréquentant un milieu d’escrocs et de mafieux de bas étage) entre brutalement en conflit avec la personnalité de l’individu qui y réside (le personnage principal n’ayant pas la carrure ni l’âme d’un criminel). Comment cette équation peut-elle se résoudre ? Par la victoire et la défaite simultanée des deux frères : soit le héros réussit et fait sortir son frère de prison mais en ayant perdu son âme par la même occasion ; soit le héros échoue à accomplir ses braquages et ne fait pas libérer son frère mais parvient à conserver son intégrité physique et surtout morale. C’est aussi un film sur le poids de l’héritage légué par la vieille génération à la nouvelle, chaque jeune personnage étant chargé de s’occuper d’un être âgé (mère, grand-mère, grand-père,…). Booster relève néanmoins du déjà-vu, au point qu’il reprend des morceaux de BO d’anciens films pour illustrer ses scènes, et Matt Ruskin devra faire attention par la suite à trouver une identité visuelle qui lui soit plus propre [sortie indéterminée].
Inabouti pourrait aussi être le parfait qualificatif de Booster. Lui-aussi part d’un pitch relativement simple : un homme se retrouve obligé de faire une série de cambriolages afin d’innocenter son frère coupable qui croupit en prison. Comme Una Noche et Gimme the Loot, le film de Matt Ruskin est une œuvre relatant la préparation d’un acte qui n’interviendra qu’à la toute fin du long métrage. On peut donc aussi considérer qu’au même titre que l’œuvre de Lucy Mulloy, Booster s’arrête un peu là où il aurait dû commencer. Mais ce dernier s’élève un peu plus grâce à une forme plutôt agréable à suivre. On reconnaitra clairement l’influence de Michael Mann et de ses nombreux ersatz dans cette manière de filmer un environnement urbain ou de décrire comment le déterminisme social (le héros fréquentant un milieu d’escrocs et de mafieux de bas étage) entre brutalement en conflit avec la personnalité de l’individu qui y réside (le personnage principal n’ayant pas la carrure ni l’âme d’un criminel). Comment cette équation peut-elle se résoudre ? Par la victoire et la défaite simultanée des deux frères : soit le héros réussit et fait sortir son frère de prison mais en ayant perdu son âme par la même occasion ; soit le héros échoue à accomplir ses braquages et ne fait pas libérer son frère mais parvient à conserver son intégrité physique et surtout morale. C’est aussi un film sur le poids de l’héritage légué par la vieille génération à la nouvelle, chaque jeune personnage étant chargé de s’occuper d’un être âgé (mère, grand-mère, grand-père,…). Booster relève néanmoins du déjà-vu, au point qu’il reprend des morceaux de BO d’anciens films pour illustrer ses scènes, et Matt Ruskin devra faire attention par la suite à trouver une identité visuelle qui lui soit plus propre [sortie indéterminée].  Partant d’un pitch d’anticipation minimaliste, Robot & Frank, le film de S.F. à petit budget de Jake Schreier, se révèle être un agréable divertissement. Si le film n’invente rien de formellement nouveau et qu’il suit docilement toutes les étapes classiques d’un récit « indé » (avec les scories que cela peut sous-entendre), il parvient à construire un « buddy movie » assez original et bien écrit. D’un côté il y a Frank, un vieux cambrioleur de prestige à la retraite dont la mémoire commence à partir en lambeaux et qui est interprété brillamment par un Franck Langella portant clairement le long métrage sur ses épaules. De l’autre, il y a le robot aide-soignant que le fils de Frank lui a adjoint de force. D’abord réticent face à cette obscure machine apparemment dénuée de personnalité et de volonté propre, symbole d’un avenir qu’il ne comprend pas et qu’il n’aura pas le temps de voir se développer, Frank va apprendre à accepter cette machine et à la considérer comme son unique « ami » afin de retrouver une nouvelle jeunesse. Une histoire d’amitié et de pardon dans l’ensemble très touchante, drôle et jamais lourde qui ne se départit pas d’un certain message avec un hymne poignant et pertinent sur la tolérance. C’est aussi une belle œuvre sur notre propre rapport à la vie et à la mort [19.09.2012].
Partant d’un pitch d’anticipation minimaliste, Robot & Frank, le film de S.F. à petit budget de Jake Schreier, se révèle être un agréable divertissement. Si le film n’invente rien de formellement nouveau et qu’il suit docilement toutes les étapes classiques d’un récit « indé » (avec les scories que cela peut sous-entendre), il parvient à construire un « buddy movie » assez original et bien écrit. D’un côté il y a Frank, un vieux cambrioleur de prestige à la retraite dont la mémoire commence à partir en lambeaux et qui est interprété brillamment par un Franck Langella portant clairement le long métrage sur ses épaules. De l’autre, il y a le robot aide-soignant que le fils de Frank lui a adjoint de force. D’abord réticent face à cette obscure machine apparemment dénuée de personnalité et de volonté propre, symbole d’un avenir qu’il ne comprend pas et qu’il n’aura pas le temps de voir se développer, Frank va apprendre à accepter cette machine et à la considérer comme son unique « ami » afin de retrouver une nouvelle jeunesse. Une histoire d’amitié et de pardon dans l’ensemble très touchante, drôle et jamais lourde qui ne se départit pas d’un certain message avec un hymne poignant et pertinent sur la tolérance. C’est aussi une belle œuvre sur notre propre rapport à la vie et à la mort [19.09.2012].  Tout comme Robot & Frank, le film de Rebecca Thomas, Electrick Children, dispose d’un point de départ assez original. Une jeune fille, Rachel, incarnée par l’absolument excellente Julia Garner, est élevée dans une communauté mormone retirée du monde. Tout va pour le mieux lorsqu’au cours d’un moment de bravade elle découvre subitement la musique rock. Une découverte qui a une conséquence assez inattendue puisqu’elle tombe miraculeusement enceinte alors qu’elle est vierge. La communauté refusant de croire à ce soudain miracle qu’elle ne cessait pourtant pas de prêcher, Rachel quitte le village pour partir dans le vaste et inconnu monde moderne pour trouver à qui appartient cette magnifique voix qui l’a soudainement engrossée. Elle est accompagnée dans son périple par Will (Liam Aiken), un jeune garçon qui, à cause d’un malentendu, est perçu par la communauté mormone comme étant en fait l’amant secret de la jeune fille. On ne peut s’empêcher de penser au Village de M. Night Shyamalan qui racontait aussi comment une jeune femme se libérait de l’emprise et de l’angoisse des adultes pour oser traverser la forêt entourant son vieux village renfermé et découvrir ce que masquait tous ces arbres. Cependant Electrick Children n’est pas un thriller mais plutôt un road-movie quelque peu autobiographique (la réalisatrice ayant été mormone et ayant quitté cette communauté aux règles stricts après avoir découvert le cinéma). Le problème avec ces artistes mormons (Jason Reitman et Stephenie Meyer en tête), c’est qu’il est toujours un peu difficile pour le spectateur averti d’appréhender sereinement leurs œuvres et de ne pas essayer d’y voir tout un tas de messages passéistes, moralisateurs et familiaux dans ces scènes parfois très premier degré. Si la première heure laisse place à un aspect décalé assez sympathique, les trente dernières minutes laissent place au doute quant aux motivations de la réalisatrice. Au final, retour vers la nature, vers la famille, vers le mariage, vers l’autarcie, vers le refus de la modernité… Une dernière note un peu désagréable qui conclut un film qui se perd un peu en rebondissements vers la fin, mais qui demeure un moment assez agréable. Et l’esthétique un peu surréaliste du film est loin d’être déplaisante, ce qui peut amener à penser qu’on entendra bientôt reparler de Rebecca Thomas [09.01.2013].
Tout comme Robot & Frank, le film de Rebecca Thomas, Electrick Children, dispose d’un point de départ assez original. Une jeune fille, Rachel, incarnée par l’absolument excellente Julia Garner, est élevée dans une communauté mormone retirée du monde. Tout va pour le mieux lorsqu’au cours d’un moment de bravade elle découvre subitement la musique rock. Une découverte qui a une conséquence assez inattendue puisqu’elle tombe miraculeusement enceinte alors qu’elle est vierge. La communauté refusant de croire à ce soudain miracle qu’elle ne cessait pourtant pas de prêcher, Rachel quitte le village pour partir dans le vaste et inconnu monde moderne pour trouver à qui appartient cette magnifique voix qui l’a soudainement engrossée. Elle est accompagnée dans son périple par Will (Liam Aiken), un jeune garçon qui, à cause d’un malentendu, est perçu par la communauté mormone comme étant en fait l’amant secret de la jeune fille. On ne peut s’empêcher de penser au Village de M. Night Shyamalan qui racontait aussi comment une jeune femme se libérait de l’emprise et de l’angoisse des adultes pour oser traverser la forêt entourant son vieux village renfermé et découvrir ce que masquait tous ces arbres. Cependant Electrick Children n’est pas un thriller mais plutôt un road-movie quelque peu autobiographique (la réalisatrice ayant été mormone et ayant quitté cette communauté aux règles stricts après avoir découvert le cinéma). Le problème avec ces artistes mormons (Jason Reitman et Stephenie Meyer en tête), c’est qu’il est toujours un peu difficile pour le spectateur averti d’appréhender sereinement leurs œuvres et de ne pas essayer d’y voir tout un tas de messages passéistes, moralisateurs et familiaux dans ces scènes parfois très premier degré. Si la première heure laisse place à un aspect décalé assez sympathique, les trente dernières minutes laissent place au doute quant aux motivations de la réalisatrice. Au final, retour vers la nature, vers la famille, vers le mariage, vers l’autarcie, vers le refus de la modernité… Une dernière note un peu désagréable qui conclut un film qui se perd un peu en rebondissements vers la fin, mais qui demeure un moment assez agréable. Et l’esthétique un peu surréaliste du film est loin d’être déplaisante, ce qui peut amener à penser qu’on entendra bientôt reparler de Rebecca Thomas [09.01.2013].  Le nouveau film de Lynn Shelton (Humpday), intitulé Your Sister’s Sister, a été diffusé assez tôt dans la compétition. On peut par conséquent dire qu’il s’agissait du tout premier coup de cœur de Deauville. Une œuvre applaudie et reçue avec une ferveur plutôt méritée. Là encore, il s’agit en grande partie d’un huis-clos. Jack (Mark Duplass) est un jeune homme normal mais un peu paumé depuis la mort de son frère un an auparavant. Pour se ressourcer et essayer de repartir dans la vie sur des bases plus saines, son amie de toujours, Iris (incarné par une très émouvante Emily Blunt), lui propose de passer quelques temps dans la maison familiale se trouvant sur une île et soi-disant vide pour les mois à venir. Avec réticence, le jeune héros accepte finalement la proposition avant de découvrir que la maison n’est évidemment pas vacante puisqu’elle est occupée par la sœur déprimée d’Iris, Hannah (Rosemarie DeWitt). Your Sister’s Sister relate l’implosion d’un trio « amoureux » avec une certaine légèreté qui permet d’élever le long métrage plutôt que de le plomber. Jamais morbide, étonnamment joyeux, plutôt dynamique et bien écrit, le film de Shelton est une comédie dramatique « indé » vraiment aboutie. Si on peut légitimement regretter qu’il s’agit plus d’un film d’acteurs et de scénaristes, la mise en scène n’étant pas forcément ce qu’il y a de plus marquant dans Your Sister’s Sister, le long métrage de Shelton dilue un humour bienvenu tout en se permettant de traiter de quelques thèmes assez audacieux (dont l’adoption par un homosexuel). Le long métrage se conclue par une belle idée, qui n’est pas sans rappeler She Hate Me de Spike Lee, bien qu’on puisse regretter le procédé final roublard et facile consistant à couper le long métrage avant que la question principale qui sous-tend le film ne puisse obtenir sa fatidique réponse (un peu comme dans Shame de Steve McQueen et, dans une moindre mesure, Inception de Christopher Nolan). Une dernière note désagréable qui ne parvient heureusement pas à entacher cet ensemble vraiment divertissant et émouvant [10.04.2013].
Le nouveau film de Lynn Shelton (Humpday), intitulé Your Sister’s Sister, a été diffusé assez tôt dans la compétition. On peut par conséquent dire qu’il s’agissait du tout premier coup de cœur de Deauville. Une œuvre applaudie et reçue avec une ferveur plutôt méritée. Là encore, il s’agit en grande partie d’un huis-clos. Jack (Mark Duplass) est un jeune homme normal mais un peu paumé depuis la mort de son frère un an auparavant. Pour se ressourcer et essayer de repartir dans la vie sur des bases plus saines, son amie de toujours, Iris (incarné par une très émouvante Emily Blunt), lui propose de passer quelques temps dans la maison familiale se trouvant sur une île et soi-disant vide pour les mois à venir. Avec réticence, le jeune héros accepte finalement la proposition avant de découvrir que la maison n’est évidemment pas vacante puisqu’elle est occupée par la sœur déprimée d’Iris, Hannah (Rosemarie DeWitt). Your Sister’s Sister relate l’implosion d’un trio « amoureux » avec une certaine légèreté qui permet d’élever le long métrage plutôt que de le plomber. Jamais morbide, étonnamment joyeux, plutôt dynamique et bien écrit, le film de Shelton est une comédie dramatique « indé » vraiment aboutie. Si on peut légitimement regretter qu’il s’agit plus d’un film d’acteurs et de scénaristes, la mise en scène n’étant pas forcément ce qu’il y a de plus marquant dans Your Sister’s Sister, le long métrage de Shelton dilue un humour bienvenu tout en se permettant de traiter de quelques thèmes assez audacieux (dont l’adoption par un homosexuel). Le long métrage se conclue par une belle idée, qui n’est pas sans rappeler She Hate Me de Spike Lee, bien qu’on puisse regretter le procédé final roublard et facile consistant à couper le long métrage avant que la question principale qui sous-tend le film ne puisse obtenir sa fatidique réponse (un peu comme dans Shame de Steve McQueen et, dans une moindre mesure, Inception de Christopher Nolan). Une dernière note désagréable qui ne parvient heureusement pas à entacher cet ensemble vraiment divertissant et émouvant [10.04.2013].  God Bless America
God Bless America Les deux films suivants, outre leurs grandes qualités, ont un point commun : le thème de l’alcoolisme. D’abord avec Smashed de James Ponsoldt qui suit une jeune institutrice, interprétée par Mary Elizabeth Winstead (Le Boulevard de la Mort, Scott Pilgrim), ayant un sérieux problème d’alcool au point que celle-ci décide de reprendre les choses en main. En effet, son secret a été à deux doigts d’être découvert après avoir fait cours à de petits enfants alors qu’elle souffrait d’une sérieuse gueule de bois. Il faut dire qu’elle n’est pas aidée par son mari, lui aussi soiffard de compétition. D’ailleurs leur amour n’était-il finalement pas intrinsèquement lié à l’alcool ? Car une fois que l’un des deux membres du couple se retrouve sobre et peut admirer à loisir son partenaire sombrant dans l’ivresse, la communication, ou du moins la communion des deux ne parait plus possible. Ne partageant plus cette même folie et cette même addiction, le rapport autrefois égal entre la jeune femme et son mari est réduit à néant. Smashed peut donc se voir à travers plusieurs niveaux de lecture. C’est d’abord l’histoire du combat d’une femme contre l’alcool. Un parcours laborieux et épuisant visant à sa désintoxication et à sa réinsertion en société. C’est aussi une histoire d’amour dans le sens où le film retrace la tentative de survie d’un couple face à une tempête imprévue : la soudaine décision de ne plus boire, amenant nécessairement le mari à soutenir, ou non, sa femme dans cette lutte de tous les instants. C’est enfin un film sur l’âge adulte. La jeune prof agissait en effet comme une adolescente sans prendre réellement la mesure de ses actes. La sobriété doit lui permettre d’aborder sa vie et le monde de façon plus sérieuse et responsable. Là encore malgré un sujet assez lourd, Ponsoldt n’hésite pas à le contrebalancer avec un peu d’humour et de légèreté. Bien écrit, quoiqu’assez classique dans son déroulement, Smashed est surtout l’occasion pour la très prometteuse Mary Elizabeth Winstead de trouver son premier grand rôle. Au vu de sa performance assez magistrale, gageons qu’il est fort probable qu’on la retrouve cette année aux oscars pour sa première nomination très méritée dans la catégorie de la meilleure actrice principale [sortie indéterminée].
Les deux films suivants, outre leurs grandes qualités, ont un point commun : le thème de l’alcoolisme. D’abord avec Smashed de James Ponsoldt qui suit une jeune institutrice, interprétée par Mary Elizabeth Winstead (Le Boulevard de la Mort, Scott Pilgrim), ayant un sérieux problème d’alcool au point que celle-ci décide de reprendre les choses en main. En effet, son secret a été à deux doigts d’être découvert après avoir fait cours à de petits enfants alors qu’elle souffrait d’une sérieuse gueule de bois. Il faut dire qu’elle n’est pas aidée par son mari, lui aussi soiffard de compétition. D’ailleurs leur amour n’était-il finalement pas intrinsèquement lié à l’alcool ? Car une fois que l’un des deux membres du couple se retrouve sobre et peut admirer à loisir son partenaire sombrant dans l’ivresse, la communication, ou du moins la communion des deux ne parait plus possible. Ne partageant plus cette même folie et cette même addiction, le rapport autrefois égal entre la jeune femme et son mari est réduit à néant. Smashed peut donc se voir à travers plusieurs niveaux de lecture. C’est d’abord l’histoire du combat d’une femme contre l’alcool. Un parcours laborieux et épuisant visant à sa désintoxication et à sa réinsertion en société. C’est aussi une histoire d’amour dans le sens où le film retrace la tentative de survie d’un couple face à une tempête imprévue : la soudaine décision de ne plus boire, amenant nécessairement le mari à soutenir, ou non, sa femme dans cette lutte de tous les instants. C’est enfin un film sur l’âge adulte. La jeune prof agissait en effet comme une adolescente sans prendre réellement la mesure de ses actes. La sobriété doit lui permettre d’aborder sa vie et le monde de façon plus sérieuse et responsable. Là encore malgré un sujet assez lourd, Ponsoldt n’hésite pas à le contrebalancer avec un peu d’humour et de légèreté. Bien écrit, quoiqu’assez classique dans son déroulement, Smashed est surtout l’occasion pour la très prometteuse Mary Elizabeth Winstead de trouver son premier grand rôle. Au vu de sa performance assez magistrale, gageons qu’il est fort probable qu’on la retrouve cette année aux oscars pour sa première nomination très méritée dans la catégorie de la meilleure actrice principale [sortie indéterminée].  California Solo
California Solo Et on en arrive au grand choc de cette compétition officielle du Festival de Deauville. Présenté quasiment à la toute fin du Festival, le film de Benh Zeitlin a pris au dépourvu tout le monde au dépourvu. D’abord parce qu’il est quasiment le seul film de la compétition à posséder quelques éléments lyriques et fantastiques ; tous les autres étant régulièrement assez terre-à-terre en termes de pitch et/ou de traitement formel (à l’exception de Wrong). Là où l’on avait surtout eu droit à du drame ou à de la comédie, même dans le cadre de Robot & Frank et de God Bless America, Les Bêtes du Sud Sauvage propose une vision un peu plus « féérique » du monde. Le long métrage de Zeitlin est une sorte de conte initiatique lyrique. Le film suit Hushpuppy, petite fille de six ans vivant dans le bayou avec son père. Dans cette zone de non-droit où l’homme est à la merci du moindre caprice de Mère Nature, vivent (réellement) plusieurs communautés d’hommes qui se sont sciemment installés dans ces marécages pouvant les engloutir à la moindre tempête tropicale. La vie de cette petite fille, que son père malade a tendance à éduquer comme un homme, suit son cours paisiblement. Mais lorsque la fameuse tempête se déchaine enfin (un écho évident à l’ouragan Katrina), Hushpuppy et quelques rescapés tentent de survivre à l’inondation causée par les immenses digues en béton que la civilisation moderne a dressée pour se protéger. Mais la nature réserve d’autres surprises et les gaz à effet de serre diffusés dans l’atmosphère par cette société industrielle ayant perdue tout contact avec l’écosystème permet soudain de libérer des glaces les terribles aurochs, taureaux géants carnivores, qui dévoraient les humains pendant les Temps Anciens. Malgré la richesse des thèmes et intrigues qu’il aborde, Les Bêtes… demeure clairement un film grand public. Un long métrage à hauteur d’enfant qui suit une « jeune princesse » tentant d’accomplir sa quête héroïque pour sauver son père souffrant d’un problème cardiaque. Entre mysticisme et naturalisme, le film de Zeitlin n’est pas sans rappeler dans une moindre mesure évidemment les œuvres de Terrence Malick mais aussi la littérature de Marc Twain. On pense aussi à plusieurs reprises aux films de Spielberg (E.T., L’Empire du Soleil, A.I.) et de Miyazaki (Mon Voisin Totoro, Ponyo sur la falaise particulièrement) dans cette manière de représenter un imaginaire enfantin onirique et la quête visant à retrouver et à sauver ceux qu’ils aiment. Rarement un enfant avait été aussi bien écrit et dirigé au cinéma depuis les deux cinéastes précités. Malgré un tournage difficile s’étant déroulé sur les vrais lieux de l’action, Zeitlin parvient à réaliser un premier film non seulement marquant mais aussi très abouti. Et si l’on pourra regretter de menus défauts (un abus de la caméra à l’épaule au cours d’une poignée de séquences, quelques effets spéciaux hasardeux dus à un budget réduit), Les Bêtes… s’impose immédiatement comme les débuts tonitruants d’un réalisateur dont il est fort probable que le nom va compter dans les années à venir. Un grand prix très mérité qui fut magnifiquement reçu par un public Deauvillais qui donna à Zeitlin une longue et légitime « standing ovation » [12.12.2012].
Et on en arrive au grand choc de cette compétition officielle du Festival de Deauville. Présenté quasiment à la toute fin du Festival, le film de Benh Zeitlin a pris au dépourvu tout le monde au dépourvu. D’abord parce qu’il est quasiment le seul film de la compétition à posséder quelques éléments lyriques et fantastiques ; tous les autres étant régulièrement assez terre-à-terre en termes de pitch et/ou de traitement formel (à l’exception de Wrong). Là où l’on avait surtout eu droit à du drame ou à de la comédie, même dans le cadre de Robot & Frank et de God Bless America, Les Bêtes du Sud Sauvage propose une vision un peu plus « féérique » du monde. Le long métrage de Zeitlin est une sorte de conte initiatique lyrique. Le film suit Hushpuppy, petite fille de six ans vivant dans le bayou avec son père. Dans cette zone de non-droit où l’homme est à la merci du moindre caprice de Mère Nature, vivent (réellement) plusieurs communautés d’hommes qui se sont sciemment installés dans ces marécages pouvant les engloutir à la moindre tempête tropicale. La vie de cette petite fille, que son père malade a tendance à éduquer comme un homme, suit son cours paisiblement. Mais lorsque la fameuse tempête se déchaine enfin (un écho évident à l’ouragan Katrina), Hushpuppy et quelques rescapés tentent de survivre à l’inondation causée par les immenses digues en béton que la civilisation moderne a dressée pour se protéger. Mais la nature réserve d’autres surprises et les gaz à effet de serre diffusés dans l’atmosphère par cette société industrielle ayant perdue tout contact avec l’écosystème permet soudain de libérer des glaces les terribles aurochs, taureaux géants carnivores, qui dévoraient les humains pendant les Temps Anciens. Malgré la richesse des thèmes et intrigues qu’il aborde, Les Bêtes… demeure clairement un film grand public. Un long métrage à hauteur d’enfant qui suit une « jeune princesse » tentant d’accomplir sa quête héroïque pour sauver son père souffrant d’un problème cardiaque. Entre mysticisme et naturalisme, le film de Zeitlin n’est pas sans rappeler dans une moindre mesure évidemment les œuvres de Terrence Malick mais aussi la littérature de Marc Twain. On pense aussi à plusieurs reprises aux films de Spielberg (E.T., L’Empire du Soleil, A.I.) et de Miyazaki (Mon Voisin Totoro, Ponyo sur la falaise particulièrement) dans cette manière de représenter un imaginaire enfantin onirique et la quête visant à retrouver et à sauver ceux qu’ils aiment. Rarement un enfant avait été aussi bien écrit et dirigé au cinéma depuis les deux cinéastes précités. Malgré un tournage difficile s’étant déroulé sur les vrais lieux de l’action, Zeitlin parvient à réaliser un premier film non seulement marquant mais aussi très abouti. Et si l’on pourra regretter de menus défauts (un abus de la caméra à l’épaule au cours d’une poignée de séquences, quelques effets spéciaux hasardeux dus à un budget réduit), Les Bêtes… s’impose immédiatement comme les débuts tonitruants d’un réalisateur dont il est fort probable que le nom va compter dans les années à venir. Un grand prix très mérité qui fut magnifiquement reçu par un public Deauvillais qui donna à Zeitlin une longue et légitime « standing ovation » [12.12.2012]. 
 Au début de sa carrière, Tony Scott pouvait être perçu comme un Michael Bay avant l’heure tant la presse spécialisée vomissait ses films à gros budgets privilégiant la technologie et la pyrotechnie plutôt que l’humain (ce qui s’est, sur le long terme, révélé assez faux). Tony Scott suivit son frère dans sa passion pour le cinéma en jouant à l’âge de 16 ans dans Boy and Bicycle, court métrage de ce dernier. Tony Scott intégra ensuite la Sunderland Art School, le Royal College of Art de Londres ainsi que le Leeds College of Arts. Ridley et Tony Scott fondèrent ensuite la RSA en 1973, une compagnie publicitaire avec laquelle ils tourneront chacun plusieurs centaines de publicité pendant près d’une décennie.
Au début de sa carrière, Tony Scott pouvait être perçu comme un Michael Bay avant l’heure tant la presse spécialisée vomissait ses films à gros budgets privilégiant la technologie et la pyrotechnie plutôt que l’humain (ce qui s’est, sur le long terme, révélé assez faux). Tony Scott suivit son frère dans sa passion pour le cinéma en jouant à l’âge de 16 ans dans Boy and Bicycle, court métrage de ce dernier. Tony Scott intégra ensuite la Sunderland Art School, le Royal College of Art de Londres ainsi que le Leeds College of Arts. Ridley et Tony Scott fondèrent ensuite la RSA en 1973, une compagnie publicitaire avec laquelle ils tourneront chacun plusieurs centaines de publicité pendant près d’une décennie. La véritable consécration vint avec son second long métrage : le célébrissime Top Gun. Film d’action retraçant le parcours de quelques têtes brulées cherchant à devenir les plus brillants pilotes de l’air de l’armée américaine, le long métrage rencontra un succès international effarant au point d’engendrer une vague de vocations qui entraina une hausse des inscriptions dans les écoles de pilotages. Le film révéla Tom Cruise et le transforma en superstar (Cruise doit à Tony Scott toute sa future carrière). Si on ne peut nier qu’il s’agit d’un film de propagande pour la grandeur de l’armée américaine, soutien de l’US Air Force oblige, Top Gun est aussi un gros morceau d’action devenu culte. Certaines séquences iconiques sont restées gravées dans l’inconscient collectif, la BO est toujours aussi géante (pour peu qu’on soit sensible au disco kitsch) et les scènes de voltige demeurent encore indépassées. Petite touche finale : un excellent casting (Val Kilmer, Tom Skerritt, Michael Ironside, Tim Robbins ou encore Kelly McGillis) enrobe ce blockbuster de haut standing.
La véritable consécration vint avec son second long métrage : le célébrissime Top Gun. Film d’action retraçant le parcours de quelques têtes brulées cherchant à devenir les plus brillants pilotes de l’air de l’armée américaine, le long métrage rencontra un succès international effarant au point d’engendrer une vague de vocations qui entraina une hausse des inscriptions dans les écoles de pilotages. Le film révéla Tom Cruise et le transforma en superstar (Cruise doit à Tony Scott toute sa future carrière). Si on ne peut nier qu’il s’agit d’un film de propagande pour la grandeur de l’armée américaine, soutien de l’US Air Force oblige, Top Gun est aussi un gros morceau d’action devenu culte. Certaines séquences iconiques sont restées gravées dans l’inconscient collectif, la BO est toujours aussi géante (pour peu qu’on soit sensible au disco kitsch) et les scènes de voltige demeurent encore indépassées. Petite touche finale : un excellent casting (Val Kilmer, Tom Skerritt, Michael Ironside, Tim Robbins ou encore Kelly McGillis) enrobe ce blockbuster de haut standing. La même année sortit Jours de Tonnerre (Days of Thunder), simili remake de Top Gun transposé dans le milieu automobile. On retrouve Tom Cruise dans le rôle-titre de ce film à sa gloire qu’il co-écrit avec Robert Towne (scénariste de Bonnie et Clyde). Cruise incarne une nouvelle tête brulée qui va parvenir à remporter le tournoi « Nascar » et à s’imposer comme un conducteur de légende. Le scénario est archi-classique et le film est l’un des moins aimés par les cinéphiles. Il s’agit pourtant d’un film d’action malgré tout très jubilatoire, doté d’une réalisation efficace et d’une bande-son d’Hans Zimmer absolument magistrale. Le film fut à son tour un immense succès populaire. Un de mes petits préférés, personnellement (et oui, j’assume).
La même année sortit Jours de Tonnerre (Days of Thunder), simili remake de Top Gun transposé dans le milieu automobile. On retrouve Tom Cruise dans le rôle-titre de ce film à sa gloire qu’il co-écrit avec Robert Towne (scénariste de Bonnie et Clyde). Cruise incarne une nouvelle tête brulée qui va parvenir à remporter le tournoi « Nascar » et à s’imposer comme un conducteur de légende. Le scénario est archi-classique et le film est l’un des moins aimés par les cinéphiles. Il s’agit pourtant d’un film d’action malgré tout très jubilatoire, doté d’une réalisation efficace et d’une bande-son d’Hans Zimmer absolument magistrale. Le film fut à son tour un immense succès populaire. Un de mes petits préférés, personnellement (et oui, j’assume). Le film d’après ne rencontra pas sur le moment un succès populaire important. Adapté d’un scénario de Quentin Tarantino alors que ce dernier s’attelait à sa première réalisation, Reservoir Dogs, True Romance sortit en salles en 1993. Une relecture moderne de « Bonnie et Clyde », une romance criminelle à petit budget qui, par la qualité de son script et le nom de son réalisateur qui avait eu un vrai coup de foudre pour ce dernier, réunit un casting de premier choix venu parfois pour des rôles très secondaires. On retrouve autour de Christian Slater et de Patricia Arquette quelques pointures comme Gary Oldman, Val Kilmer, Tom Sizemore, Brad Pitt, Samuel L. Jackson ainsi que Dennis Hooper et Christopher Walken pour une séquence considérée comme l’une des meilleures des années 90. Là encore, c’est un combo gagnant entre un scénario aux répliques percutantes, des interprétations inspirées, une mise en scène impressionnante et une bande son mythique. Petit succès en salle, True Romance est considéré aujourd’hui comme l’une des deux-trois œuvres les plus marquantes et abouties de Tony Scott.
Le film d’après ne rencontra pas sur le moment un succès populaire important. Adapté d’un scénario de Quentin Tarantino alors que ce dernier s’attelait à sa première réalisation, Reservoir Dogs, True Romance sortit en salles en 1993. Une relecture moderne de « Bonnie et Clyde », une romance criminelle à petit budget qui, par la qualité de son script et le nom de son réalisateur qui avait eu un vrai coup de foudre pour ce dernier, réunit un casting de premier choix venu parfois pour des rôles très secondaires. On retrouve autour de Christian Slater et de Patricia Arquette quelques pointures comme Gary Oldman, Val Kilmer, Tom Sizemore, Brad Pitt, Samuel L. Jackson ainsi que Dennis Hooper et Christopher Walken pour une séquence considérée comme l’une des meilleures des années 90. Là encore, c’est un combo gagnant entre un scénario aux répliques percutantes, des interprétations inspirées, une mise en scène impressionnante et une bande son mythique. Petit succès en salle, True Romance est considéré aujourd’hui comme l’une des deux-trois œuvres les plus marquantes et abouties de Tony Scott. Il se rattrapa néanmoins très vite avec un doublé assez percutant de films d’espionnage réalistes. Le premier est Ennemi d’Etat (Enemy of the State) en 1998 qui met en scène Will Smith dans l’un de ses meilleurs rôles. Il y interprète un avocat traqué par le gouvernement après qu’il soit malencontreusement tombé sur la preuve d’un complot visant, sur le long terme, à faire passer de force une très antidémocratique politique de surveillance de la population. Film d’action ultra divertissant et prémonitoire, Ennemi d’Etat est une extension un tantinet bourrine du Conversation Secrète de Francis Ford Coppola (d’une certaine manière, Gene Hackman reprenait le rôle qu’il y tenait). Un film important dans la carrière de Scott puisque c’est à partir de ce moment-là qu’il ne va plus arrêter de triturer l’image, de décortiquer ses limites, de multiplier les points de vue et les effets,… Bref, d’expérimenter son média dans des blockbusters faussement formatés.
Il se rattrapa néanmoins très vite avec un doublé assez percutant de films d’espionnage réalistes. Le premier est Ennemi d’Etat (Enemy of the State) en 1998 qui met en scène Will Smith dans l’un de ses meilleurs rôles. Il y interprète un avocat traqué par le gouvernement après qu’il soit malencontreusement tombé sur la preuve d’un complot visant, sur le long terme, à faire passer de force une très antidémocratique politique de surveillance de la population. Film d’action ultra divertissant et prémonitoire, Ennemi d’Etat est une extension un tantinet bourrine du Conversation Secrète de Francis Ford Coppola (d’une certaine manière, Gene Hackman reprenait le rôle qu’il y tenait). Un film important dans la carrière de Scott puisque c’est à partir de ce moment-là qu’il ne va plus arrêter de triturer l’image, de décortiquer ses limites, de multiplier les points de vue et les effets,… Bref, d’expérimenter son média dans des blockbusters faussement formatés. On arrive à la dernière étape de la filmographie de Tony Scott. Celle où il a poussé l’expérimentation visuelle à son plus haut niveau. L’autre point commun de cette partie est Denzel Washington qui tient le rôle-titre de quatre des cinq films restants. Le premier fut Man on Fire en 2004, remake du film éponyme d’Elie Chouraqui sorti en 1987 et déjà adapté d’un roman d’A.J. Quinnell. Formellement très novateur et avec un Washington au sommet de sa forme, le film est scénarisé par Brian Helgeland. Le long métrage raconte la relation qui s’établit entre un garde du corps alcoolique et la petite fille (Dakota Fanning) qu’il est chargé de protéger, avant que celle-ci ne se fasse enlever. De tous ses films, Man on Fire est clairement considéré comme le plus abouti de Tony Scott. Un polar majeur de ces deux dernières décennies. L’aboutissement d’un style, d’une esthétique dans un film d’une grande intensité et d’une profonde humanité.
On arrive à la dernière étape de la filmographie de Tony Scott. Celle où il a poussé l’expérimentation visuelle à son plus haut niveau. L’autre point commun de cette partie est Denzel Washington qui tient le rôle-titre de quatre des cinq films restants. Le premier fut Man on Fire en 2004, remake du film éponyme d’Elie Chouraqui sorti en 1987 et déjà adapté d’un roman d’A.J. Quinnell. Formellement très novateur et avec un Washington au sommet de sa forme, le film est scénarisé par Brian Helgeland. Le long métrage raconte la relation qui s’établit entre un garde du corps alcoolique et la petite fille (Dakota Fanning) qu’il est chargé de protéger, avant que celle-ci ne se fasse enlever. De tous ses films, Man on Fire est clairement considéré comme le plus abouti de Tony Scott. Un polar majeur de ces deux dernières décennies. L’aboutissement d’un style, d’une esthétique dans un film d’une grande intensité et d’une profonde humanité. Au final, si l’œuvre de Tony Scott n’atteint pas celle d’un Kubrick (qui l’a atteinte de toute façon ?), elle n’en reste pas moins comme une filmographie suffisamment marquante pour avoir influencée près de trois décennies de cinéma américain. Un style qui a été repris voire singé par Paul Greengrass ou Michael Bay. Jamais illisible, son montage était avant tout d’une efficacité et d’une maitrise assez impressionnante. Il a inventé de nombreux effets visuels qui furent par la suite réutilisés par bon nombre de cinéastes de films d’action, d’espionnage ou de thrillers. Une œuvre qu’on a précocement considéré comme sans âme et opportuniste. Au final, il est pourtant absolument évident que Tony Scott est un « auteur » ; un titre qu’on lui refuse depuis toujours pour l’attribuer à son grand frère si brillant (alors que la filmographie de ce dernier ne contient pour le coup quasiment aucun fil rouge, que ce soit esthétique, thématique ou narratif).
Au final, si l’œuvre de Tony Scott n’atteint pas celle d’un Kubrick (qui l’a atteinte de toute façon ?), elle n’en reste pas moins comme une filmographie suffisamment marquante pour avoir influencée près de trois décennies de cinéma américain. Un style qui a été repris voire singé par Paul Greengrass ou Michael Bay. Jamais illisible, son montage était avant tout d’une efficacité et d’une maitrise assez impressionnante. Il a inventé de nombreux effets visuels qui furent par la suite réutilisés par bon nombre de cinéastes de films d’action, d’espionnage ou de thrillers. Une œuvre qu’on a précocement considéré comme sans âme et opportuniste. Au final, il est pourtant absolument évident que Tony Scott est un « auteur » ; un titre qu’on lui refuse depuis toujours pour l’attribuer à son grand frère si brillant (alors que la filmographie de ce dernier ne contient pour le coup quasiment aucun fil rouge, que ce soit esthétique, thématique ou narratif).
 Après le succès colossal d’Avengers produit par Marvel, il n’a pas fallu attendre très longtemps. La société de « comics » rivale DC entend bien réactiver son projet équivalent intitulé La Ligue des Justiciers. Il s’agit d’un pendant des Avengers qui voit la réunion de quelques uns des super-héros les plus iconiques des éditions DC parmi lesquels on compte Batman, Superman, Wonder Woman, le Flash ou encore Green Lantern. Une réunion démesurée de super-héros qui nécessitera un budget bien conséquent et un script en béton. En effet, à l’inverse d’Avengers, tous les supers-héros de la Ligue n’ont pas été introduit dans des longs-métrages précédents. Il n’y a bien que Superman et Batman qui ont eu auparavant les honneurs du grand écran. Cela impliquerait donc de les présenter pour la première fois dans un film de deux heures trente, tout en leur donnant suffisamment d’actions et d’aventures pour que le long-métrage ne paraisse pas comme la laborieuse introduction d’un second épisode. Un projet difficile qui nécessitera un très sérieux et efficace travail d’écriture, d’autant plus qu’une menace à combattre devra elle aussi être introduite et trouver sa place dans ce court délai de temps. L’homme choisi pour cela est le jeune scénariste « hype » du prochain Gangster Squad, Will Beal.
Après le succès colossal d’Avengers produit par Marvel, il n’a pas fallu attendre très longtemps. La société de « comics » rivale DC entend bien réactiver son projet équivalent intitulé La Ligue des Justiciers. Il s’agit d’un pendant des Avengers qui voit la réunion de quelques uns des super-héros les plus iconiques des éditions DC parmi lesquels on compte Batman, Superman, Wonder Woman, le Flash ou encore Green Lantern. Une réunion démesurée de super-héros qui nécessitera un budget bien conséquent et un script en béton. En effet, à l’inverse d’Avengers, tous les supers-héros de la Ligue n’ont pas été introduit dans des longs-métrages précédents. Il n’y a bien que Superman et Batman qui ont eu auparavant les honneurs du grand écran. Cela impliquerait donc de les présenter pour la première fois dans un film de deux heures trente, tout en leur donnant suffisamment d’actions et d’aventures pour que le long-métrage ne paraisse pas comme la laborieuse introduction d’un second épisode. Un projet difficile qui nécessitera un très sérieux et efficace travail d’écriture, d’autant plus qu’une menace à combattre devra elle aussi être introduite et trouver sa place dans ce court délai de temps. L’homme choisi pour cela est le jeune scénariste « hype » du prochain Gangster Squad, Will Beal. Emma Watson s’ajoute au casting de Noah, le prochain film de Darren Aronofsky (Requiem of a Dream, Black Swan et qui avait été pendant quelques temps prévu à la place de Nolan pour rebooter la franchise Batman). Le film, comme son titre l’indique, retracera le parcours de Noé pour la création d’une Arche alors que le Déluge s’apprête à s’abattre pour détruire l’humanité. Elle y incarnera Ila dont le fils de Noé, Sem, tomba amoureux. Ce blockbuster apocalyptique à morale « écologique » sortira en mars 2014 aux Etats-Unis avec un tournage débutant cet été. Russell Crowe y incarnera Noé, et devrait être accompagné de Jennifer Connelly, Douglas Booth ainsi que de Logan Lerman (Percy Jackson). Ray Winstone pourrait allonger le casing mais la présence de Saoirse Ronan n’est plus aussi certaine que quelques semaines auparavant. On ne sait pas si Emma Watson jouera dans Your Voice in My Head, drame sur une jeune journaliste dépressive et un psychiatre qui devait aussi être mis en scène par David Yates cet été avant que ce dernier ne s’en aille. Elle aura cependant un des rôles principaux, au côté de Logan Lerman justement, dans Perks of Being a Wallflower et aura un petit rôle dans le film The End of the World de et avec Seth Roger (ainsi que Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Danny McBride, Jason Segel, Rihanna et Michael Cera) prévu pour 2013. Elle tourne actuellement The Bling Ring de Sofia Coppola.
Emma Watson s’ajoute au casting de Noah, le prochain film de Darren Aronofsky (Requiem of a Dream, Black Swan et qui avait été pendant quelques temps prévu à la place de Nolan pour rebooter la franchise Batman). Le film, comme son titre l’indique, retracera le parcours de Noé pour la création d’une Arche alors que le Déluge s’apprête à s’abattre pour détruire l’humanité. Elle y incarnera Ila dont le fils de Noé, Sem, tomba amoureux. Ce blockbuster apocalyptique à morale « écologique » sortira en mars 2014 aux Etats-Unis avec un tournage débutant cet été. Russell Crowe y incarnera Noé, et devrait être accompagné de Jennifer Connelly, Douglas Booth ainsi que de Logan Lerman (Percy Jackson). Ray Winstone pourrait allonger le casing mais la présence de Saoirse Ronan n’est plus aussi certaine que quelques semaines auparavant. On ne sait pas si Emma Watson jouera dans Your Voice in My Head, drame sur une jeune journaliste dépressive et un psychiatre qui devait aussi être mis en scène par David Yates cet été avant que ce dernier ne s’en aille. Elle aura cependant un des rôles principaux, au côté de Logan Lerman justement, dans Perks of Being a Wallflower et aura un petit rôle dans le film The End of the World de et avec Seth Roger (ainsi que Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Danny McBride, Jason Segel, Rihanna et Michael Cera) prévu pour 2013. Elle tourne actuellement The Bling Ring de Sofia Coppola. Tarsem Singh avait impressionné avec ses premières réalisations, dont The Fall, mais ses derniers longs-métrages ont laissé un gout d’inachevé et d’assez anodin (Les Immortels, Blanche Neige). Mais cela fait quelques années qu’il poursuit le projet d’un long-métrage sur Marco Polo, fameux marchand vénitien du XIIIème siècle qui a parcouru toute l’Asie. Quoi de mieux qu’un film sur l’un des plus grands symboles de la relation Occident/Orient pour cette coproduction américano-chinoise ? D’autant plus que Singh est d’origine indienne et laissera sans aucun doute exprimer ses influences orientales. Le projet vient en effet de recevoir un coup de pouce car, si on ne sait pas qui incarnera Marco Polo (aux prémices du projet on parlait de Matt Damon), on sait dorénavant que Gong Li (Miami Vice) sera de la partie. A noter que le phénomène de coproductions cinématographiques entre les USA et la Chine se multiplie, montrant que le marché asiatique est dorénavant bien perçu par les majors comme non négligeable. L’exemple du prochain Iron Man 3 peut ainsi en attester.
Tarsem Singh avait impressionné avec ses premières réalisations, dont The Fall, mais ses derniers longs-métrages ont laissé un gout d’inachevé et d’assez anodin (Les Immortels, Blanche Neige). Mais cela fait quelques années qu’il poursuit le projet d’un long-métrage sur Marco Polo, fameux marchand vénitien du XIIIème siècle qui a parcouru toute l’Asie. Quoi de mieux qu’un film sur l’un des plus grands symboles de la relation Occident/Orient pour cette coproduction américano-chinoise ? D’autant plus que Singh est d’origine indienne et laissera sans aucun doute exprimer ses influences orientales. Le projet vient en effet de recevoir un coup de pouce car, si on ne sait pas qui incarnera Marco Polo (aux prémices du projet on parlait de Matt Damon), on sait dorénavant que Gong Li (Miami Vice) sera de la partie. A noter que le phénomène de coproductions cinématographiques entre les USA et la Chine se multiplie, montrant que le marché asiatique est dorénavant bien perçu par les majors comme non négligeable. L’exemple du prochain Iron Man 3 peut ainsi en attester. Les réalisateurs de Tempête de boulettes géantes et de 21 Jump Street continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils sont maintenant à la tête de l’adaptation de « Carter Beats the Devil » écrit par Glen David Gold en 2001. Depuis près d’une décennie, Hollywood a tenté d’adapter l’ouvrage, notamment Tom Cruise qui souhaitait en interpréter le premier rôle dans un scénario du grand Robert Towne (le script de Bonnie et Clyde). L’adaptation avait même été tentée dans un format de série à la télé, mais sans succès. L’histoire se déroule dans les années 20 et suit Carter, un magicien ayant réellement existé, qui fait un tour de magie impliquant le président de l’époque, Warren G. Harding. Ce dernier est retrouvé mort peu après et tous les soupçons se portent alors sur le magicien. L’histoire fictive est pleine de noms ayant vraiment existés dont Houdini ou encore les Marx Brothers. Un livre complexe à adapter mais cela ne devrait pas être trop difficile pour le duo qui a su tirer de beaux longs-métrages à succès d’un livre décalé pour enfants puis d’une série TV kitsch. En attendant, Miller et Lord s’attaquent à un film d’animation en image de synthèse sur les Lego. Le résultat devrait être inventif et inattendu.
Les réalisateurs de Tempête de boulettes géantes et de 21 Jump Street continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils sont maintenant à la tête de l’adaptation de « Carter Beats the Devil » écrit par Glen David Gold en 2001. Depuis près d’une décennie, Hollywood a tenté d’adapter l’ouvrage, notamment Tom Cruise qui souhaitait en interpréter le premier rôle dans un scénario du grand Robert Towne (le script de Bonnie et Clyde). L’adaptation avait même été tentée dans un format de série à la télé, mais sans succès. L’histoire se déroule dans les années 20 et suit Carter, un magicien ayant réellement existé, qui fait un tour de magie impliquant le président de l’époque, Warren G. Harding. Ce dernier est retrouvé mort peu après et tous les soupçons se portent alors sur le magicien. L’histoire fictive est pleine de noms ayant vraiment existés dont Houdini ou encore les Marx Brothers. Un livre complexe à adapter mais cela ne devrait pas être trop difficile pour le duo qui a su tirer de beaux longs-métrages à succès d’un livre décalé pour enfants puis d’une série TV kitsch. En attendant, Miller et Lord s’attaquent à un film d’animation en image de synthèse sur les Lego. Le résultat devrait être inventif et inattendu.
 Un court compte-rendu de Cannes pour commencer. A partir des nombreux rapports des journalistes présents sur place, on peut déjà dire que la compétition a plutôt déçu et qu’hormis deux ou trois longs-métrages (le Haneke, le Léos Carax ou encore le Audiard) aucun film n’a vraiment fait l’effet d’une bombe cinématographique. Dimanche dernier, le jury présidé par Nanni Moretti a tranché. Le moins que l’on puisse dire c’est que les récompenses sont à la hauteur de la compétition : très décevantes, parfois incompréhensibles. La Palme revient ainsi à Amour de Michael Haneke (trois ans après Le Ruban Blanc) pour un film sur la vieillesse qui devrait donner un coup de boost à la vente de Prozac. Le grand Prix revient à l’inégal (parait-il) Reality de Matteo Garrone tandis que le Prix du Jury revient à un long-métrage (parait-il) assez mineur de Ken Loach, La Part des Anges. Le prix d’interprétation masculine revient à Mads Mikkelsen pour le film descendu en flammes La Chasse de Thomas Vinterberg tandis que le prix d’interprétation féminine revient à égalité à Cosmina Stratan et Cristina Flutur, deux actrices d’Au-delà des collines de Cristian Mungiu (qui a aussi reçu le prix du scénario). Enfin, le film du mexicain Carlos Reygadas, le (de nouveau parait-il) peu convaincant Post Tenebras Lux, succède à Drive pour le prix de la mise en scène (ce qui, au vu du teaser, semble assez regrettable puisque le film parait filmé à travers le cul d’une bouteille). En l’état donc, pas de promotion d’un nouvel auteur puisque trois anciens palmés ont été récompensé et un ancien Grand Prix a eu de nouveau un Grand Prix. D’autant plus que des soupçons de copinage apparaissent déjà, quatre des films récompensés étant produits ou distribués par la société « Le Pacte »,… la société qui a produit la plupart des longs-métrages de Nanni Moretti.
Un court compte-rendu de Cannes pour commencer. A partir des nombreux rapports des journalistes présents sur place, on peut déjà dire que la compétition a plutôt déçu et qu’hormis deux ou trois longs-métrages (le Haneke, le Léos Carax ou encore le Audiard) aucun film n’a vraiment fait l’effet d’une bombe cinématographique. Dimanche dernier, le jury présidé par Nanni Moretti a tranché. Le moins que l’on puisse dire c’est que les récompenses sont à la hauteur de la compétition : très décevantes, parfois incompréhensibles. La Palme revient ainsi à Amour de Michael Haneke (trois ans après Le Ruban Blanc) pour un film sur la vieillesse qui devrait donner un coup de boost à la vente de Prozac. Le grand Prix revient à l’inégal (parait-il) Reality de Matteo Garrone tandis que le Prix du Jury revient à un long-métrage (parait-il) assez mineur de Ken Loach, La Part des Anges. Le prix d’interprétation masculine revient à Mads Mikkelsen pour le film descendu en flammes La Chasse de Thomas Vinterberg tandis que le prix d’interprétation féminine revient à égalité à Cosmina Stratan et Cristina Flutur, deux actrices d’Au-delà des collines de Cristian Mungiu (qui a aussi reçu le prix du scénario). Enfin, le film du mexicain Carlos Reygadas, le (de nouveau parait-il) peu convaincant Post Tenebras Lux, succède à Drive pour le prix de la mise en scène (ce qui, au vu du teaser, semble assez regrettable puisque le film parait filmé à travers le cul d’une bouteille). En l’état donc, pas de promotion d’un nouvel auteur puisque trois anciens palmés ont été récompensé et un ancien Grand Prix a eu de nouveau un Grand Prix. D’autant plus que des soupçons de copinage apparaissent déjà, quatre des films récompensés étant produits ou distribués par la société « Le Pacte »,… la société qui a produit la plupart des longs-métrages de Nanni Moretti. Isabelle Huppert continue d’étoffer sa filmographie déjà incroyablement riche en y ajoutant deux nouveaux projets. Le premier est le prochain film de Marco Bellochio (Vincere) intitulé La Bella Addomentata. Inspiré de l’histoire vraie d’Eluana Englaro qui fit polémique, le film aura pour sujet central la question de l’euthanasie. En effet, Eluana avait été victime en 1992 d’un accident de voiture qui l’avait laissé dans un état végétatif irréversible et son père, certain du choix qu’elle aurait fait, lutta pour lui accorder le droit de mourir. Huppert devrait aussi participer au remake du Suspiria de Dario Argento que le réalisateur David Gordon Green porte depuis de nombreuses années. Elle sera entourée d’Isabelle Fuhrman (Esther), qui remplace Natalie Portman qui avait pendant longtemps conservé le rôle principal, Michael Nyqvist (Millenium, Mission Impossible 4), Janet McTeer et Antje Traue. Le tournage de ce remake polémique commencera en septembre prochain. Huppert sera enfin sur les écrans notamment dans le prochain film d’Hong Sang-soo présenté à Cannes, In Another Country, et le nouveau thriller de Niels Arden Oplev (trilogie suédoise de Millenium), Dead Man Down, avec Noomi Rapace et Colin Farrell.
Isabelle Huppert continue d’étoffer sa filmographie déjà incroyablement riche en y ajoutant deux nouveaux projets. Le premier est le prochain film de Marco Bellochio (Vincere) intitulé La Bella Addomentata. Inspiré de l’histoire vraie d’Eluana Englaro qui fit polémique, le film aura pour sujet central la question de l’euthanasie. En effet, Eluana avait été victime en 1992 d’un accident de voiture qui l’avait laissé dans un état végétatif irréversible et son père, certain du choix qu’elle aurait fait, lutta pour lui accorder le droit de mourir. Huppert devrait aussi participer au remake du Suspiria de Dario Argento que le réalisateur David Gordon Green porte depuis de nombreuses années. Elle sera entourée d’Isabelle Fuhrman (Esther), qui remplace Natalie Portman qui avait pendant longtemps conservé le rôle principal, Michael Nyqvist (Millenium, Mission Impossible 4), Janet McTeer et Antje Traue. Le tournage de ce remake polémique commencera en septembre prochain. Huppert sera enfin sur les écrans notamment dans le prochain film d’Hong Sang-soo présenté à Cannes, In Another Country, et le nouveau thriller de Niels Arden Oplev (trilogie suédoise de Millenium), Dead Man Down, avec Noomi Rapace et Colin Farrell.  John Hillcoat, qui était à Cannes pour Des hommes sans loi (autrefois connu sous le titre Lawless), devrait ensuite réaliser un de ses vieux projets, Triple Nine. Il s’agit d’un film policier qui mettra en scène un groupe de flics corrompus qui se retrouvent piégés dans un engrenage infernal après avoir fait un énorme casse. L’unique façon de s’en sortir : tuer l’un des leurs. La cible alors désignée est un jeune officier qui devrait être incarné par Shia LaBeouf. Le film est produit par la jeune productrice héritière Megan Ellison qui avait déjà sauvée à temps Lawless et qui peut déjà se vanter de soutenir (voire de sauver) financièrement quelques films d’auteurs « peu connus » tels True Grit des frères Coen, The Master de Paul Thomas Anderson, Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow ou encore Cogan – la mort en douce de Dominik. L’artiste Nick Cage, qui a travaillé sur la plupart des longs-métrages de Hillcoat, devrait revenir pour composer la musique.
John Hillcoat, qui était à Cannes pour Des hommes sans loi (autrefois connu sous le titre Lawless), devrait ensuite réaliser un de ses vieux projets, Triple Nine. Il s’agit d’un film policier qui mettra en scène un groupe de flics corrompus qui se retrouvent piégés dans un engrenage infernal après avoir fait un énorme casse. L’unique façon de s’en sortir : tuer l’un des leurs. La cible alors désignée est un jeune officier qui devrait être incarné par Shia LaBeouf. Le film est produit par la jeune productrice héritière Megan Ellison qui avait déjà sauvée à temps Lawless et qui peut déjà se vanter de soutenir (voire de sauver) financièrement quelques films d’auteurs « peu connus » tels True Grit des frères Coen, The Master de Paul Thomas Anderson, Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow ou encore Cogan – la mort en douce de Dominik. L’artiste Nick Cage, qui a travaillé sur la plupart des longs-métrages de Hillcoat, devrait revenir pour composer la musique. D’autres réalisateurs reconnus viennent de dévoiler quelques uns de leurs nouveaux projets. Il y a d’abord Luc Besson (Nikita, Léon, Le Cinquième Elément) qui semble avoir abandonné l’idée de la retraite ainsi que son mystérieux film de S.F. à gros budget. Après Michelle Yeoh dans The Lady, Besson va faire tourner Robert de Niro dans Malavita. Cette adaptation du roman éponyme de Tonino Benacquista suivra un vieux gangster qui bénéficie d’un programme de protection des témoins et qui se retrouve caché en Normandie. Mais tout ne va évidemment pas aussi bien se passer que prévu.
D’autres réalisateurs reconnus viennent de dévoiler quelques uns de leurs nouveaux projets. Il y a d’abord Luc Besson (Nikita, Léon, Le Cinquième Elément) qui semble avoir abandonné l’idée de la retraite ainsi que son mystérieux film de S.F. à gros budget. Après Michelle Yeoh dans The Lady, Besson va faire tourner Robert de Niro dans Malavita. Cette adaptation du roman éponyme de Tonino Benacquista suivra un vieux gangster qui bénéficie d’un programme de protection des témoins et qui se retrouve caché en Normandie. Mais tout ne va évidemment pas aussi bien se passer que prévu. Ridley Scott se réattelle aux univers qu’il a popularisé au début de sa carrière. Après avoir fait sa « prequel qui n’en serait pas une » d’Alien avec Prometheus, et après avoir mis en scène le script de Cormac McCarthy The Counselor avec Michael Fassbender, Javier Bardem et Brad Pitt, Scott s’attèlera à une « sequel qui n’en serait pas une » de son immense chef d’œuvre Blade Runner. Hampton Fincher, le scénariste de ce dernier, est actuellement en train de travailler avec Scott sur la future histoire qui mettra cette fois en scène un premier rôle féminin, ce qui ne devrait pas permettre un retour d’Harrison Ford (ce qui n’est pas plus mal car cela évitera de répondre à la fameuse question de la « nature » de Deckard). Néanmoins, Scott a dévoilé son désir d’inclure le personnage de Deckard et donc d’une certaine manière Ford dans l’histoire, mais il n’en serait pas le nœud principal.
Ridley Scott se réattelle aux univers qu’il a popularisé au début de sa carrière. Après avoir fait sa « prequel qui n’en serait pas une » d’Alien avec Prometheus, et après avoir mis en scène le script de Cormac McCarthy The Counselor avec Michael Fassbender, Javier Bardem et Brad Pitt, Scott s’attèlera à une « sequel qui n’en serait pas une » de son immense chef d’œuvre Blade Runner. Hampton Fincher, le scénariste de ce dernier, est actuellement en train de travailler avec Scott sur la future histoire qui mettra cette fois en scène un premier rôle féminin, ce qui ne devrait pas permettre un retour d’Harrison Ford (ce qui n’est pas plus mal car cela évitera de répondre à la fameuse question de la « nature » de Deckard). Néanmoins, Scott a dévoilé son désir d’inclure le personnage de Deckard et donc d’une certaine manière Ford dans l’histoire, mais il n’en serait pas le nœud principal. Les studios américains n’ont pas l’intention de réitérer le Noël catastrophique de l’année précédente où les blockbusters Millenium, Cheval de Guerre, Tintin ou encore Nouveau Départ s’étaient battus pour grappiller les morceaux du box office ; lutte où aucun film était ressorti indemne financièrement. Petit problème : la période entre le 19 et le 25 décembre devrait pourtant être encore pire puisqu’il réunira Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow (le film sur la traque d’Oussama Ben Laden), This is Forty de Judd Apatow (long-métrage mettant en scène des personnages secondaires d’En Cloque – mode d’emploi), l’adaptation d’une nouvelle de « Jack Reacher » par McQuarrie et avec Tom Cruise dans le rôle titre, le prochain Tarantino Django Unchained et The Great Gatsby de Baz Luhrmann avec pour les deux DiCaprio, ainsi que Life of Pi d’Ang Lee. Ce dernier fait ainsi un mouvement plus astucieux en avançant sa sortie d’un mois, le 21 novembre, une place plus libre depuis les reports de 47 Ronin et surtout, de façon fort regrettable, de Gravity d’Alfonso Cuaron (tout deux ne sont pas prévus avant 2013). Un changement de date qui ne devrait en rien enlever le statut de compétiteur à oscar au film de Lee qui a sérieusement impressionné il y a quelques semaines en dévoilant ses premières images à une petite portion du public.
Les studios américains n’ont pas l’intention de réitérer le Noël catastrophique de l’année précédente où les blockbusters Millenium, Cheval de Guerre, Tintin ou encore Nouveau Départ s’étaient battus pour grappiller les morceaux du box office ; lutte où aucun film était ressorti indemne financièrement. Petit problème : la période entre le 19 et le 25 décembre devrait pourtant être encore pire puisqu’il réunira Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow (le film sur la traque d’Oussama Ben Laden), This is Forty de Judd Apatow (long-métrage mettant en scène des personnages secondaires d’En Cloque – mode d’emploi), l’adaptation d’une nouvelle de « Jack Reacher » par McQuarrie et avec Tom Cruise dans le rôle titre, le prochain Tarantino Django Unchained et The Great Gatsby de Baz Luhrmann avec pour les deux DiCaprio, ainsi que Life of Pi d’Ang Lee. Ce dernier fait ainsi un mouvement plus astucieux en avançant sa sortie d’un mois, le 21 novembre, une place plus libre depuis les reports de 47 Ronin et surtout, de façon fort regrettable, de Gravity d’Alfonso Cuaron (tout deux ne sont pas prévus avant 2013). Un changement de date qui ne devrait en rien enlever le statut de compétiteur à oscar au film de Lee qui a sérieusement impressionné il y a quelques semaines en dévoilant ses premières images à une petite portion du public.
/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)